Voilà ce que je me disais dès que j'ouvrais l'œil et que je voyais ma cellule dans la prison de Moundsville, mes chers potes et auditeurs, avant que le gardien vienne frapper les barreaux avec sa matraque et se mette à gueuler, José, debout ! Sors des chiottes, on va changer l'eau ! Et je me pressais le citron, mon frère, mais je ne trouvais qu'u écran vide, un mur de béton semblable aux tours du bagne, ma tête était vide et je me disais, José, tu as bien quelque chose en mémoire, non ? Cherche au fond, cherche, t'es tombé d'un cocotier ou quoi ? Même les grenouilles ont un poids dans ce monde, dit la Bible, et je cherchais et cherchais, mais que dalle, je voyais au loin une colline de gravats et de cailloux, des baraques en tôle tenus par des cordes, un terrain vague du quartier latino, près du stade de l'Orange Bowl survolé par des charognards, et un mur troué. Ou encore, un pont piétonnier jonché de déchets organiques, bouteilles de soda vides, coulées d'un liquide foncé, crotte de chien séchée. C'était ce que j'avais à l'esprit quand je me réveillais et que je pensais à mes origines de Latino, à mon continent dont j'étais dépossédé, qui était loin de moi comme si j'étais sa lèpre. Le continent qui m'avait abandonné, expulsé, et que j'aimais plus que tout, mes loulous, que j'avais aimé et jamais eu.
Je crevais d'envie de voir un visage ou de me rappeler une voix, je me disais que quelqu'un avait dû être heureux avec moi une fois, même quelques minutes, non ? Mais que dalle, juste des images froides et distantes, journaux balayés au passage des bus sur l'avenue, mouches, nourriture avariée, seringues usagées, serviettes hygiéniques maculées de sang séché et noirci, et quand le gardien recommençait à hurler, José, trente secondes ! Je pensais que quelqu'un avait bien dû me concevoir pour me larguer dans ce merdier. Quelle tête pouvait bien avoir cette femme ou cette pierre ou ce mollusque, alors je sortais de ma cellule et respirais l'air fétide du couloir, un, deux, trois, et je m'allongeais par terre pour faire des abdominaux, car je devais être fort, et en faisant ça je sentais une boule de feu dans les tripes, les plaintes dans les cellules me rappelaient quelque chose d'urgent, la voix d'une gosse malade me disant à l'oreille, frère, petit frère, où est la yuya d'aujourd'hui ? Et je lui répondais, t'inquiète ma poupée, dès qu'ils ouvrent la porte de la cour, je file la chercher, elle est dans ma cachette, je peux pas dire où, mais là j'ai ce qu'il faut pour aujourd'hui et pour demain aussi, si le monstre qui est dans ma poitrine et ne me laisse pas respirer ne se fâche pas trop ce soir.
Nous, les prisonniers, on sortait pour aller aux douches, puis au réfectoire pour le petit-déjeuner, mais à ce moment-là j'étais déjà dehors, mes frérots, j'avais fait escale à ma cachette et je m'étais transporté au ciel ou, comme on disait avant, je chevauchais le dragon, avec la chaleur de la yuyita dans les veines, plus agréable encore que d'avoir la bite dans le cul d'une danseuse noire d'Oriente, Cuba, Maracay, Guadeloupe ou Cartagena de Indias, ah! quel pied! mes potos, excusez la grossièreté, mais si je ne me sers pas de ce langage-là, je ne vais pas pouvoir vous transmettre ce qui est au centre de mon histoire, c'est-à-dire, sans tourner autour du pot, l'énorme bâton merdeux que j'étais avant que n'arrive dans ma vie la parole du Seigneur, de l'Unique, de Qui-tu-sais, le Brother Suprême, par la voix de son missionnaire sur terre, le révérend Walter de la Salle, qui s'appelait aussi Freddy Angel ou Joseph d'Arimathie, selon l'époque ou l'année de son permis de conduire, car sans ça, avec les changements de personnalité, même lui ne se rappelait plus ni où ni comment tout avait commencé, je parle sérieusement, mes loulous et chers auditeurs, et je peux vous dire que Freddy Angel, le premier nom de cette version caribéenne de Jésus-Christ, avait la même origine que moi, c'est-à-dire la puta calle, la putain de rue comme on dit en espanish, parce que c'est de ça qu'on parle, né en plein air, sous un auvent et élevé par un ange qui était son protecteur, un flot de lumière éblouissante autour de lui qui le préservait des embrouilles, des couteaux et même des balles, c'est pour ça qu'il s'appelait Freddy Angel, car celui qui nous protège nous donne un nom de famille.













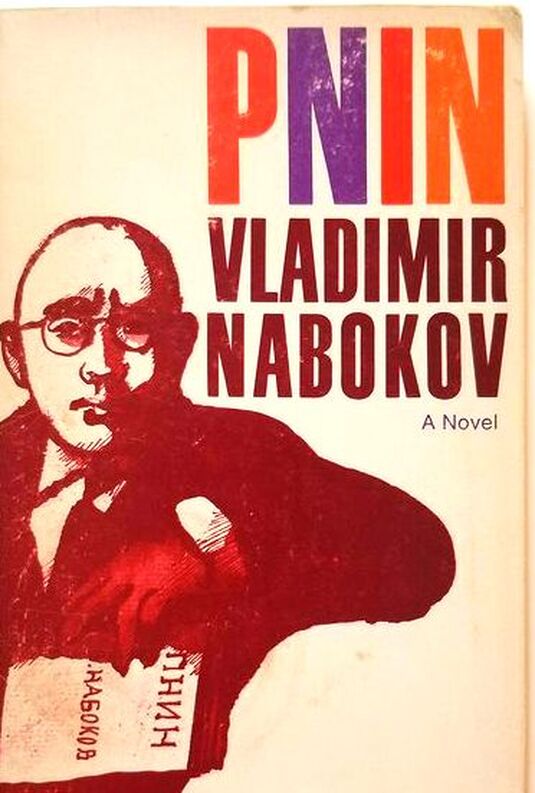
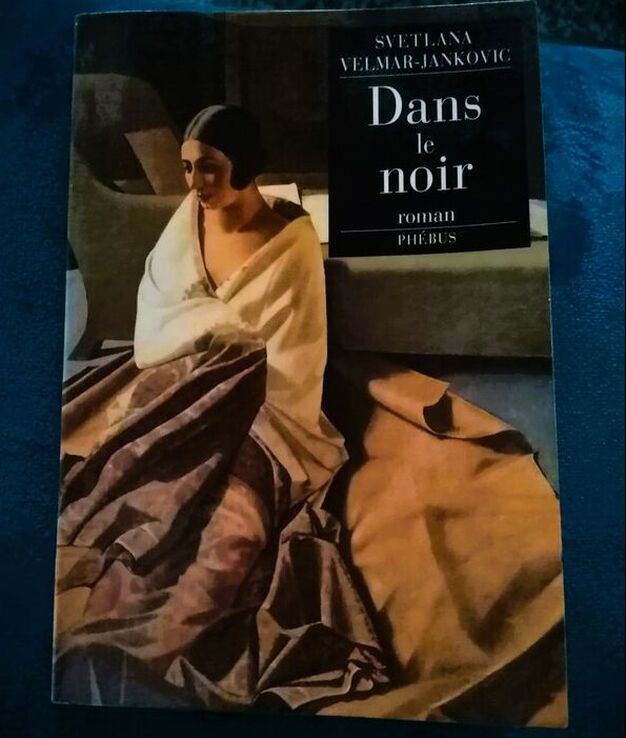





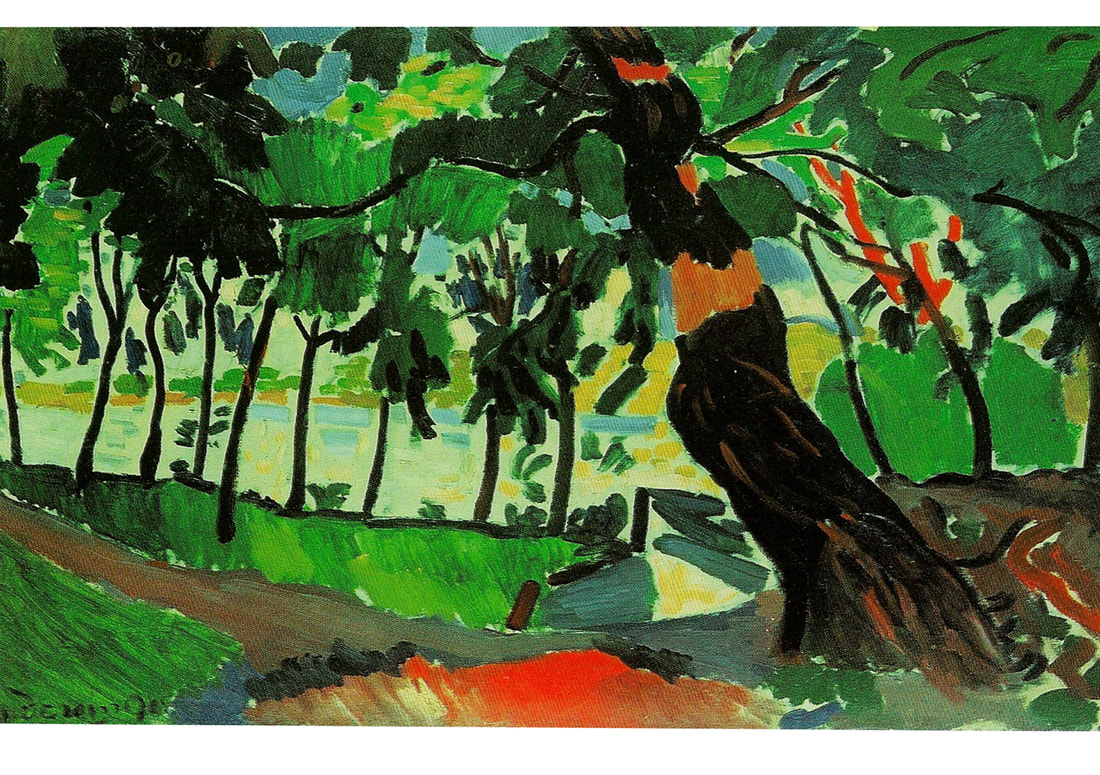




 Flux RSS
Flux RSS