Ensuite elle perdit connaissance. Les deux derniers jours elle délira sans cesse à mi-voix. Les lampes restaient allumées, funèbres, dans la chambre et dans le salon. Dans le silence d'agonie qui régnait sur la maison on n'entendait plus que le délire monotone qui sortait du lit, et l'écho sourd des éternels pas de Jordan.
Alicia mourut, enfin.Et quand la bonne entra pour défaire le lit vide, elle regarda un moment l'oreiller avec étonnement.
- Monsieur ! elle appela Jordan à voix basse. Sur l'oreiller il y a des taches qui ressemblent à du sang.
Jordan s'approcha rapidement et se pencha dessus. Effectivement, sur la taie, des deux côtés du creux qu'avait laissé la tête d'Alicia, on voyait deux petites taches sombres.
- On dirait des piqûres, murmura la bonne après l'avoir observé immobile pendant un moment.
- Approchez-le de la lumière, lui dit Jordan.
La bonne le souleva, mais elle le laissa immédiatement retomber et resta à le regarder, livide et tremblante. Sans savoir pourquoi, Jordan sentit ses poils se hérisser.
-Qu'y a-t-il ? murmura-t-il d'une voix rauque.
Il est très lourd, articula la bonne sans cesser de trembler.
Jordan le souleva; il pesait extraordinairement. Ils le prirent et, sur la table de la salle à manger, Jordan coupa la taie et la doublure d'un coup de couteau. Les plumes du dessus volèrent et la bonne, la bouche grande ouverte, poussa un cri d'horreur en portant ses mains crispées à ses bandeaux. Au fond, au milieu des plumes, remuant lentement ses pattes velues, il y avait une bête monstrueuse, une boule vivante et visqueuse. Elle était tellement enflée que sa bouche apparaissait à peine.
Nuit après nuit, depuis qu'Alicia s'était alitée, elle lui avait sournoisement appliqué sa bouche _ ou plutôt sa trompe - sur les tempes; elle avait sucé tout son sang. La piqûre était imperceptible. En secouant chaque jour son oreiller, on l'avait sans doute au début empêchée de se développer.; mais dès que la jeune femme ne put plus bouger, la succion fut vertigineuse. En cinq jours, cinq nuits, elle avait vidé Alicia.
Ces parasites d'oiseau, minuscules en milieu naturel, parviennent à acquérir dans certaines conditions des proportions énormes. Le sang humain semble leur être particulièrement favorable, et il n'est pas rare d'en trouver dans les oreillers à plumes.


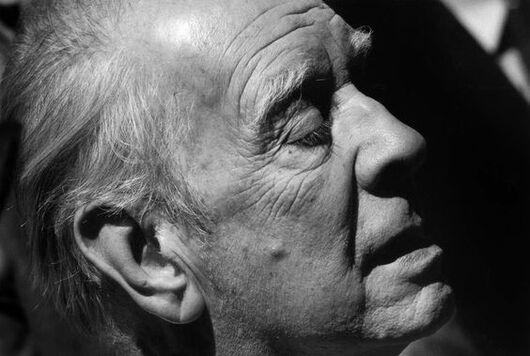



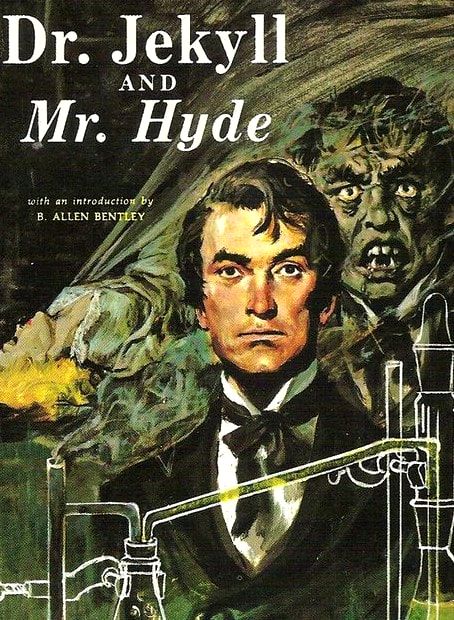
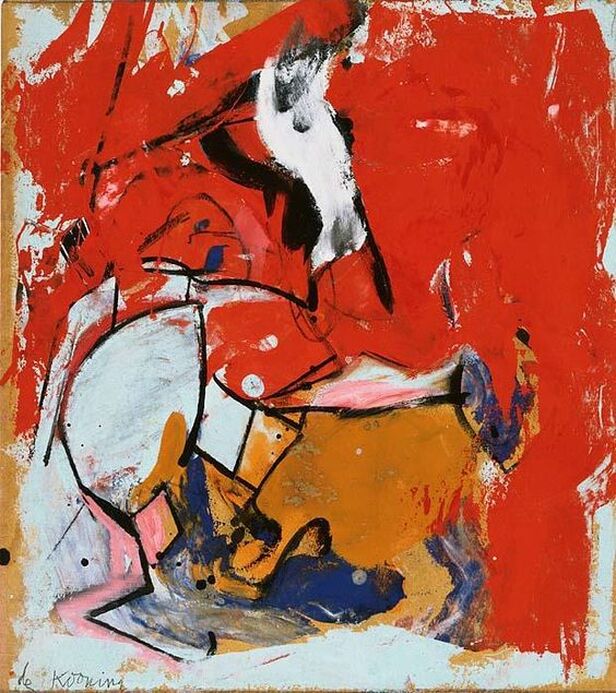




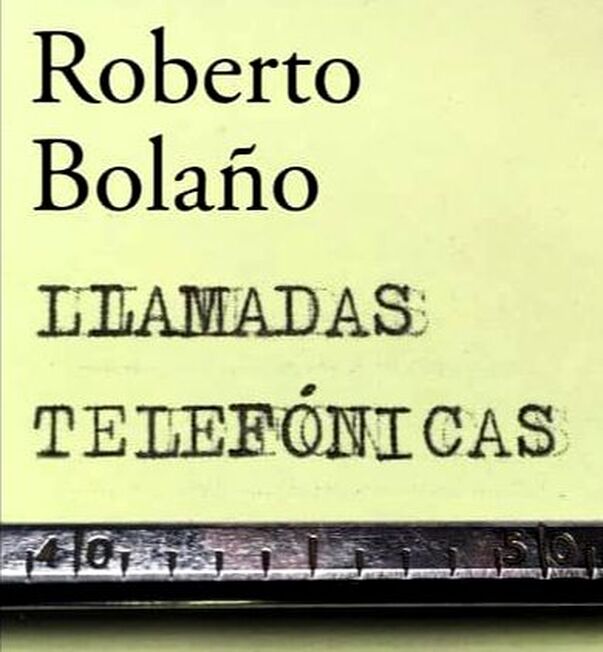








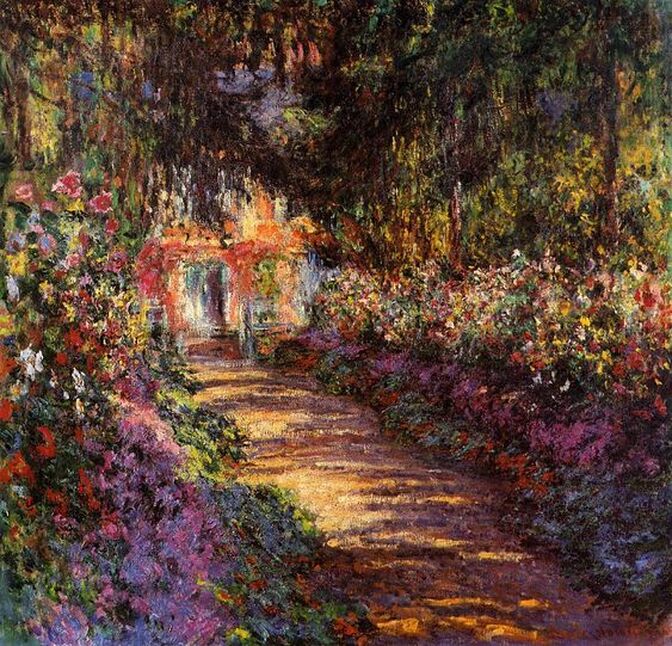




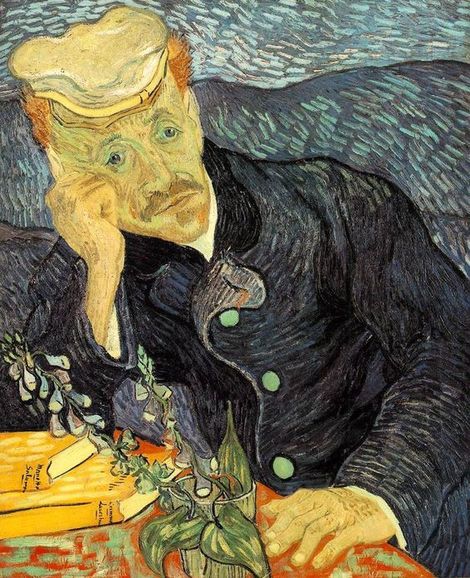

 Flux RSS
Flux RSS