Au soir de son existence, dans un carnet destiné à lui seul, le grand critique d'art Charles Millau parle avec un amour fou et un regret infini de Judith, la femme de sa vie.
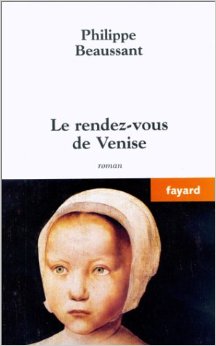
Encore un effort et je vais l'entendre. Je l'entends : mais aussitôt je m'aperçois que ce sont les mots que me renvoie ma mémoire, et pas le son. Je me souviens du plaisir que j'éprouvais à l'écouter parler. Je tendais l'oreille pour savourer la mélodie de ses phrases, et je me surprenais parfois à prêter plus d'attention aux intonations musicales de sa voix qu'à ce qu'elle me disait. Elle avait des envolées vers l'aigu à l'approche de ce rire qu'elle laissait fuser à la fin de ses phrases. Je l'attendais: c'était comme si ce qu'elle était en train de dire devait nécessairement se conclure par une mélodie pure, comme si pour elle chaque parole prononcée devait, pour aller jusqu'au bout de ce qu'elle disait, se replier et se couler aussitôt dans le bonheur intérieur qui l'habitait. Il explosait en un carillon au bout de la phrase, une espèce de grelot, un trille qui s'accrochait à la dernière syllabe après l'avoir d'avance entraînée dans ses hauteurs: et puis cela redescendait aussitôt dans une zone plus tendre et plus moelleuse qui disait "Comme je suis heureuse de ce que je viens de vous dire ! Regardez- moi, prenez- moi, emportez- moi, je suis à vous, j'aime qu'on m'aime..."
Cette nuit, dans l'obscurité de ma chambre, ayant renoncé au sommeil, je remuais dans ma tête non pas le son, mais la pensée du son de la voix de Judith : j'ai entrevu pour la première fois ce que pouvait être la mémoire d'un musicien. Je n'avais jamais songé à cela. Je les envie, ces gens pour qui le son a une substance, une matière, comme le sont pour moi les couleurs et les formes, les mouvements et les lignes.
 Flux RSS
Flux RSS