| Vers l'époque, c'était l'an dernier, où le rédacteur rencontrait (voyait, épiait, suivait, molestait sans y paraître) de plus en plus souvent et de plus en plus par hasard, par un hasard de plus en plus sauvage et ardent, en divers points, diverses rues de la ville, sur les grands, épais, fameux boulevards, dans les rues latérales désertes, sur les places comme ci-comme ça, à l'ombre protectrice des baraques à saucisses closes, sur les escaliers mécaniques ou près des ornements obscurs d'une rampe d'escalier, dans le voile mouvant d'une foule, derrière les stores baissés et dans la sensualité planchenesque d'une vitrine lambrissée, dans des appartements, dans des ateliers, sur la scène de l'ordinaire et des soirées intellectuels - la même femme à crinière, Agnès, il s'occupait justement d'écrivains est-français... |
|
0 Commentaires
Quand on résume les détails d'une vie, ce n'est rien ! Aucun fait ne semble comporter la valeur et la gravité qu'y attache la mémoire. Il ne semble même pas que d'aussi petites et banales combinaisons puissent engendrer un bonheur ou un désespoir. Le travail seul compte et les œuvres laissées. Cependant, que de choses semblent passer avant dans la vie journalière ! Quelle leçon qu'un petit carnet tenu rapidement chaque jour, avec les rendez-vous, les thés, les spectacles qui occupent une semaine et vous font croire à leur importance. Hélas ! tout se passe dans l'âme, et le drame et l'aventure ne se déroulent qu'intérieurement dans l'âme, et la vie n'est rien qu'un jeu enfantin d'une puérilité déconcertante.
L'amour lui-même n'y apporte aucune note lumineuse, ne tenant lui-même que dans les jours de la semaine qui restent éternellement des lundis, des jeudis, des dimanches, que dans les heures de la journée, soumis à des retards de pendules, à des repas, à des affaires comme le reste. La poésie, l'angoisse, les regrets infinis de ce que l'on avait cru un rêve exaucé ne sortent pas de l'âme, du cerveau, et n'entrent en rien dans le domaine visible de la vie. Voilà pourquoi les aventures et les passions des autres nous paraissent toujours si inexistantes, si peu originales et si ridicules, souvent. Nous n'en voyons que l'externe, le corps, le costume, la mimique, tandis que le patient souffre du domaine enchanté de la vie et que, malgré son récit, il ne nous transmet que bien rarement la clef du songe, ayant créé de sa substance la plus identique, de ses pensées les plus secrètes, l'aventure dont il souffre comme d'un rêve incarné et douloureux. Nous sommes impénétrables les uns aux autres, par le fait même que nous ne nous intéressons profondément qu'à nous seuls, et que nous ne cherchons dans l'amour que l'intérêt, l'étonnement, l'admiration d'un autre, un spectateur intime dans les yeux duquel nous nous imaginons reconnaître nos défauts et nos goûts. Cette fraternité seule nous unit ! Toute indépendance du partenaire nous semble une injure, une impolitesse, et nous déçoit. Nous lui en voulons d'oser être lui-même tel que sa mère le fit et l'éleva, tel qu'il est et se cherche en nous, prêt à nous haïr s'il ne se retrouve pas. -Véra, parle-moi !
Pris d'effroi, il sent alors le froid de la tombe pénétrer dans son oreille, il sent son cerveau se glacer, et il sent que Véra lui parle, mais toujours avec ce même silence qui n'en finit pas. Un silence qui devient de plus en plus angoissant, effrayant, et quand il décolle de la terre son visage blanc comme celui d'un mort, il a l'impression que l'air vibre de ce silence retentissant, comme si sur cette terrible mer s'était levée une tempête déchaînée. Ce silence le suffoque, il déferle sur sa tête en vagues glacées et agite ses cheveux, il s'écrase sur sa poitrine qui gémit sous le choc. Tremblant de tout son corps, le père Ignace se relève lentement en jetant de tous côtés des regards perçants, il fait un long, un douloureux effort pour redresser son dos et donner à son corps tremblant une posture digne. Il y parvient. Avec une lenteur délibérée, il s'essuie les genoux, remet son chapeau, bénit la tombe par trois fois, et s'en va d'un pas égal et ferme, mais il ne reconnaît pas le cimetière familier et perd son chemin. -Je me suis égaré! se dit-il en ricanant, et il s'arrête à une croisée de sentiers. Mais il n'hésite qu'une seconde et, sans réfléchir, tourne à gauche, car il ne peut rester là à attendre. Il est talonné par le silence. Il monte des tombes verdoyantes, ce silence, il émane des croix grises et tristes, de tous côtés, de dessous la terre gorgée de cadavres, il suinte en filets minces qui l'étouffent. Le pas du père Ignace se fait de plus en plus rapide. Tout assourdi, il tourne en rond sur les mêmes sentiers, enjambe des tombes, se cogne contre des grilles, s'écorche les mains et déchire le tissu fragile. Il n'a plus qu'une idée en tête : sortir d'ici. Il erre de-ci de-là, et finit par se mettre à courir sans bruit, immense et étrange avec sa soutane qui flotte au vent et sa chevelure qui vole. Quelqu'un qui aurait croisé cette silhouette sauvage courant, bondissant et agitant les bras, aurait été plus effrayé que par un mort sorti de sa tombe, en voyant ce visage de fou ricanant et grimaçant, et en entendant le râle sourd qui sortait de cette bouche ouverte. Il finit par arriver en courant sur la place au bout de laquelle se dressait la petite chapelle blanche du cimetière. Sur un banc près de l'entrée, un vieillard somnolait, visiblement un pélerin venu de loin, et à côté de lui, deux vieilles mendiantes se chamaillaient. Quand il arriva chez lui, il faisait déjà nuit, et une lumière brillait dans la chambre d'Olga Stépanovna. Sans se déshabiller ni ôter son chapeau, échevelé et couvert de poussière, il entra chez sa femme et tomba à genoux. -Mère...Olia...Aie pitié de moi ! sanglota-t-il. Je deviens fou. Il se cognait la tête contre le bord de la table et sanglotait frénétiquement, douloureusement, comme les gens qui ne pleurent jamais. Et il leva les yeux, certain qu'un miracle allait se produire, que sa femme allait parler et le prendre en pitié. -Chérie ! Il inclina son grand corps vers sa femme, et rencontra le regard de ses yeux gris. Ils n'exprimaient ni compassion ni colère. Peut-être lui avait-elle pardonné et avait-elle pitié de lui, mais dans ses yeux, il n'y avait ni pitié ni pardon. Ils étaient muets, silencieux. La maison tout entière, sombre et déserte, était silencieuse. Tabacchino fut un enfant. Tabacchino fut un loir. Tabacchino fut un chien, un oiseau, un écureuil, un amandier, un être vivant. Enfant, chien, loir, oiseau, écureuil ou amandier, il respirait, buvait de l'eau, dégageait une odeur propre, un charme spécifique, et vieillissait. En lui, il portait sa sève dont l'excès coulait sur la terre par orifices prévus ou improvisés. Le vent le décoiffait, l'ébouriffait, le rafraîchissait et parfois le tourmentait. Le premier Tabacchino à recevoir le coup de grâce fut l'amandier : la sécheresse puis les bûcherons. Pleurèrent les amateurs d'amandes, l'enfant en tête. Personne ne pourrait reconstituer l'arbre tel qu'il était. Le loir, terrifié par un hibou, succomba à une crise cardiaque, pourrit et fut dispersé par le vent. Plus le moindre signe de l'oiseau dans le ciel. Du chien cherchons vainement la tombe. Vint le tour de l'enfant, écrasé, moulu, dispersé.
A celui-là qui dispersa le corps de Tabacchino j'aurais cassé les os, ceux du tronc et ceux de la tête, j'aurais taillé dans sa peau comme dans du cuir de veau, bouleversé l'ordre des doigts et remplacé la langue par un piment du rouge le plus vif. Et le nez, par une pomme de terre germée. Il n'y a plus de Tabacchino qu'en poudre fine sur les feuilles des chênes verts, sur les toits rouges et au pied des murs décrépis. Les jardins où Tabacchino fut dispersé sont entourés de murs et plantés de vieux chênes. Ainsi on marche sur l'enfant partout où on met les pieds et cela rend maussade et prompt à la colère. Passé la crise colérique : l'oubli. D'un pied perdu, retrouvé dans du tuffeau moelleux, on ne peut pas pas pétrir un nouveau Tabacchino, à cause de l'absence de coeur qui s'est dilaté à jamais dans le froid du soir. Au départ d'une main unique et méconnaissable, on ne peut plus rien reconstruire à cause de l'éloignement du coeur. La glaise, la cendre, la silice ne suffiraient pas, même amalgamées par l'eau. Confectionnons un moule. Mais la cire ne prend pas dans l'air. Et la verge s'est retirée de son fourreau de peau et a filé de son propre chef. Elle est maintenant le peu de chair qui habite le bois de sureau ou la fleur de laurier ou la pierre. Il lui arrive encore de frémir, d'entrouvrir sa petite bouche de poisson, mais aucune bulle ne s'en échappe (à cause de l'éloignement du coeur) et aucune odeur de tilleul, d'ail, de levure, de cannelle ou de torchon sale non plus. Elle qui n'a jamais parlé ne parlera jamais. Les amandes que l'on trouve un peu partout sur le sol, légères et vides, devenues tout à fait tendres, appartenaient à Tabacchino. Il les jetait par terre, les cassait entre ses dents, contre une pierre ou entre deux galets. La terre friable, le terreau, le tuffeau moelleux des profondeurs, la craie appartenaient à Tabacchino. Il aimait la sucer, la fouiller, la mouiller et la pétrir avec des gestes d'une incroyable lenteur. Il la mouillait et jetait sur elle ses déchets qu"elle faisait disparaître. Le ciel, le beau ciel appartenait à Tabacchino. Parfois, il s'en détournait. Souvent, il le regardait, quand il était fatigué de regarder la terre sur laquelle il était posé ou vers laquelle il tombait. Les nuages, trois nuages blancs ou un énorme nuage bleu de Prusse, lui appartenaient. Le vent, le vent sec, cinglant ou doux lui appartenait. La poussière lui appartenait aussi. Il en était couvert et il en était plein. Dans l’examen des facultés et des penchants, — des mobiles primordiaux de l’âme humaine, — les phrénologistes ont oublié de faire une part à une tendance qui, bien qu’existant visiblement comme sentiment primitif, radical, irréductible, a été également omise par tous les moralistes qui les ont précédés. Dans la parfaite infatuation de notre raison, nous l’avons tous omise. Nous avons permis que son existence échappât à notre vue, uniquement par manque de croyance, — de foi, — que ce soit la foi dans la révélation ou la foi dans la cabale. L’idée ne nous en est jamais venue, simplement à cause de sa qualité surérogatoire. Nous n’avons pas senti le besoin de constater cette impulsion, — cette tendance. Nous ne pouvions pas en concevoir la nécessité. Nous ne pouvions pas saisir la notion de ce primum mobile, et, quand même elle se serait introduite de force en nous, nous n’aurions jamais pu comprendre quel rôle il jouait dans l’économie des choses humaines, temporelles ou éternelles. Il est impossible de nier que la phrénologie et une bonne partie des sciences métaphysiques ont été brassées à priori. L’homme de la métaphysique ou de la logique, bien plutôt que l’homme de l’intelligence et de l’observation, prétend concevoir les desseins de Dieu, — lui dicter des plans. Ayant ainsi approfondi à sa pleine satisfaction les intentions de Jéhovah, d’après ces dites intentions, il a bâti ses innombrables et capricieux systèmes. En matière de phrénologie, par exemple, nous avons d’abord établi, assez naturellement d’ailleurs, qu’il était dans les desseins de la Divinité que l’homme mangeât. Puis nous avons assigné à l’homme un organe d’alimentivité, et cet organe est le fouet avec lequel Dieu contraint l’homme à manger, bon gré, mal gré. En second lieu, ayant décidé que c’était la volonté de Dieu que l’homme continuât son espèce, nous avons découvert tout de suite un organe d’amativité. Et ainsi ceux de la combativité, de l’idéalité, de la causalité, de la constructivité, — bref, tout organe représentant un penchant, un sentiment moral ou une faculté de la pure intelligence. Et, dans cet emménagement des principes de l’action humaine, des spurzheimistes, à tort ou à raison, en partie ou en totalité, n’ont fait que suivre, en principe, les traces de leurs devanciers ; déduisant et établissant chaque chose d’après la destinée préconçue de l’homme et prenant pour base les intentions de son Créateur.
Il eût été plus sage, il eût été plus sûr de baser notre classification (puisqu’il nous faut absolument classifier) sur les actes que l’homme accomplit habituellement et ceux qu’il accomplit occasionnellement, toujours occasionnellement, plutôt que sur l’hypothèse que c’est la Divinité elle-même qui les lui fait accomplir. Si nous ne pouvons pas comprendre Dieu dans ses œuvres visibles, comment donc le comprendrions-nous dans ses inconcevables pensées, qui appellent ces œuvres à la vie ? Si nous ne pouvons le concevoir dans ses créatures objectives, comment le concevrons-nous dans ses modes inconditionnels et dans ses phases de création ? L’induction à posteriori aurait conduit la phrénologie à admettre comme principe primitif et inné de l’action humaine un je ne sais quoi paradoxal, que nous nommerons perversité, faute d’un terme plus caractéristique. Dans le sens que j’y attache, c’est, en réalité, un mobile sans motif, un motif non motivé. Sous son influence, nous agissons sans but intelligible ; ou, si cela apparaît comme une contradiction dans les termes, nous pouvons modifier la proposition jusqu’à dire que, sous son influence, nous agissons par la raison que nous ne le devrions pas. En théorie, il ne peut pas y avoir de raison plus déraisonnable ; mais, en fait, il n’y en a pas de plus forte. Pour certains esprits, dans de certaines conditions, elle devient absolument irrésistible. Ma vie n’est pas une chose plus certaine pour moi que cette proposition : la certitude du péché ou de l’erreur inclus dans un acte quelconque est souvent l’unique force invincible qui nous pousse, et seule nous pousse à son accomplissement. Et cette tendance accablante à faire le mal pour l’amour du mal n’admettra aucune analyse, aucune résolution en éléments ultérieurs. C’est un mouvement radical, primitif, — élémentaire. On dira, je m’y attends, que, si nous persistons dans certains actes parce que nous sentons que nous ne devrions pas y persister, notre conduite n’est qu’une modification de celle qui dérive ordinairement de la combativité phrénologique. Mais un simple coup d’œil suffira pour découvrir la fausseté de cette idée. La combativité phrénologique a pour cause d’existence la nécessité de la défense personnelle. Elle est notre sauvegarde contre l’injustice. Son principe regarde notre bien-être ; et ainsi, en même temps qu’elle se développe, nous sentons s’exalter en nous le désir du bien-être. Il suivrait de là que le désir du bien-être devrait être simultanément excité avec tout principe qui ne serait qu’une modification de la combativité ; mais, dans le cas de ce je ne sais quoi que je définis perversité, non seulement le désir du bien-être n’est pas éveillé, mais encore apparaît un sentiment singulièrement contradictoire. Tout homme, en faisant appel à son propre cœur, trouvera, après tout, la meilleure réponse au sophisme dont il s’agit. Quiconque consultera loyalement et interrogera soigneusement son âme, n’osera pas nier l’absolue radicalité du penchant en question. Il n’est pas moins caractérisé qu’incompréhensible. Il n’existe pas d’homme, par exemple, qui à un certain moment n’ait été dévoré d’un ardent désir de torturer son auditeur par des circonlocutions. Celui qui parle sait bien qu’il déplaît ; il a la meilleure intention de plaire ; il est habituellement bref, précis et clair ; le langage le plus laconique et le plus lumineux s’agite et se débat sur sa langue ; ce n’est qu’avec peine qu’il se contraint lui-même à lui refuser le passage ; il redoute et conjure la mauvaise humeur de celui auquel il s’adresse. Cependant, cette pensée le frappe, que par certaines incises et parenthèses il pourrait engendrer cette colère. Cette simple pensée suffit. Le mouvement devient une velléité, la velléité se grossit en désir, le désir se change en un besoin irrésistible, et le besoin se satisfait, — au profond regret et à la mortification du parleur, et au mépris de toutes les conséquences. Nous avons devant nous une tâche qu’il nous faut accomplir rapidement. Nous savons que tarder, c’est notre ruine. La plus importante crise de notre vie réclame avec la voix impérative d’une trompette l’action et l’énergie immédiates. Nous brûlons, nous sommes consumés de l’impatience de nous mettre à l’ouvrage ; l’avant-goût d’un glorieux résultat met toute notre âme en feu. Il faut, il faut que cette besogne soit attaquée aujourd’hui, — et cependant nous la renvoyons à demain ; — et pourquoi ? Il n’y a pas d’explication, si ce n’est que nous sentons que cela est pervers ; — servons-nous du mot sans comprendre le principe. Demain arrive, et en même temps une plus impatiente anxiété de faire notre devoir ; mais avec ce surcroît d’anxiété arrive aussi un désir ardent, anonyme de différer encore, — désir positivement terrible, parce que sa nature est impénétrable. Plus le temps fuit, plus ce désir gagne de force. Il n’y a plus qu’une heure pour l’action, cette heure est à nous. Nous tremblons par la violence du conflit qui s’agite en nous, — de la bataille entre le positif et l’indéfini, entre la substance et l’ombre. Mais, si la lutte en est venue à ce point, c’est l’ombre qui l’emporte, — nous nous débattons en vain. L’horloge sonne, et c’est le glas de notre bonheur. C’est en même temps pour l’ombre qui nous a si longtemps terrorisés le chant réveille-matin, la diane du coq victorieuse des fantômes. Elle s’envole, — elle disparaît, — nous sommes libres. La vieille énergie revient. Nous travaillerons maintenant. Hélas ! il est trop tard. Nous sommes sur le bord d’un précipice. Nous regardons dans l’abîme, — nous éprouvons du malaise et du vertige. Notre premier mouvement est de reculer devant le danger. Inexplicablement nous restons. Peu à peu notre malaise, notre vertige, notre horreur, se confondent dans un sentiment nuageux et indéfinissable. Graduellement, insensiblement, ce nuage prend une forme, comme la vapeur de la bouteille d’où s’élevait le génie des Mille et une Nuits. Mais de notre nuage, sur le bord du précipice, s’élève, de plus en plus palpable, une forme mille fois plus terrible qu’aucun génie, qu’aucun démon des fables ; et cependant ce n’est qu’une pensée, mais une pensée effroyable, une pensée qui glace la moelle même de nos os, et les pénètre des féroces délices de son horreur. C’est simplement cette idée : « Quelles seraient nos sensations durant le parcours d’une chute faite d’une telle hauteur ? » Et cette chute, — cet anéantissement foudroyant, — par la simple raison qu’ils impliquent la plus affreuse, la plus odieuse de toutes les plus affreuses et de toutes les plus odieuses images de mort et de souffrance qui se soient jamais présentées à notre imagination, — par cette simple raison, nous les désirons alors plus ardemment. Et parce que notre jugement nous éloigne violemment du bord, à cause de cela même, nous nous en rapprochons plus impétueusement. Il n’est pas dans la nature de passion plus diaboliquement impatiente que celle d’un homme qui, frissonnant sur l’arête d’un précipice, rêve de s’y jeter. Se permettre, essayer de penser un instant seulement, c’est être inévitablement perdu ; car la réflexion nous commande de nous en abstenir, et c’est à cause de cela même, dis-je, que nous ne le pouvons pas. S’il n’y a pas là un bras ami pour nous arrêter, ou si nous sommes incapables d’un soudain effort pour nous rejeter loin de l’abîme, nous nous élançons, nous sommes anéantis. Examinons ces actions et d’autres analogues, nous trouverons qu’elles résultent uniquement de l’esprit de perversité. Nous les perpétrons simplement à cause que nous sentons que nous ne le devrions pas. En deçà ou au delà, il n’y a pas de principe intelligible ; et nous pourrions, en vérité, considérer cette perversité comme une instigation directe de l’Archidémon, s’il n’était pas reconnu que parfois elle sert à l’accomplissement du bien. Si je vous en ai dit aussi long, c’était pour répondre en quelque sorte à votre question, — pour vous expliquer pourquoi je suis ici, — pour avoir à vous montrer un semblant de cause quelconque qui motive ces fers que je porte et cette cellule de condamné que j’habite. Si je n’avais pas été si prolixe, ou vous ne m’auriez pas du tout compris, ou, comme la foule, vous m’auriez cru fou. Maintenant vous percevrez facilement que je suis une des victimes innombrables du démon de la perversité. Il est impossible qu’une action ait jamais été manigancée avec une plus parfaite délibération. Pendant des semaines, pendant des mois, je méditai sur les moyens d’assassinat. Je rejetai mille plans, parce que l’accomplissement de chacun impliquait une chance de révélation. À la longue, lisant un jour quelques mémoires français, je trouvai l’histoire d’une maladie presque mortelle qui arriva à Mme Pilau, par le fait d’une chandelle accidentellement empoisonnée. L’idée frappa soudainement mon imagination. Je savais que ma victime avait l’habitude de lire dans son lit. Je savais aussi que sa chambre était petite et mal aérée. Mais je n’ai pas besoin de vous fatiguer de détails oiseux. Je ne vous raconterai pas les ruses faciles à l’aide desquelles je substituai, dans le bougeoir de sa chambre à coucher une bougie de ma composition à celle que j’y trouvai. Le matin, on trouva l’homme mort dans son lit, et le verdict du coroner fut : Mort par la visitation de Dieu. J’héritai de sa fortune, et tout alla pour le mieux pendant plusieurs années. L’idée d’une révélation n’entra pas une seule fois dans ma cervelle. Quant aux restes de la fatale bougie, je les avais moi-même anéantis. Je n’avais pas laissé l’ombre d’un fil qui pût servir à me convaincre ou même me faire soupçonner du crime. On ne saurait concevoir quel magnifique sentiment de satisfaction s’élevait dans mon sein quand je réfléchissais sur mon absolue sécurité. Pendant une très longue période de temps, je m’accoutumai à me délecter dans ce sentiment. Il me donnait un plus réel plaisir que tous les bénéfices purement matériels résultant de mon crime. Mais à la longue arriva une époque à partir de laquelle le sentiment de plaisir se transforma, par une gradation presque imperceptible, en une pensée qui me hantait et me harassait. Elle me harassait parce qu’elle me hantait. À peine pouvais-je m’en délivrer pour un instant. C’est une chose tout à fait ordinaire que d’avoir les oreilles fatiguées, ou plutôt la mémoire obsédée par une espèce de tintouin, par le refrain d’une chanson vulgaire ou par quelques lambeaux insignifiants d’opéra. Et la torture ne sera pas moindre, si la chanson est bonne en elle-même ou si l’air d’opéra est estimable. C’est ainsi qu’à la fin je me surprenais sans cesse rêvant à ma sécurité, et répétant cette phrase à voix basse : Je suis sauvé ! Un jour, tout en flânant dans les rues, je me surpris moi-même à murmurer, presque à haute voix, ces syllabes accoutumées. Dans un accès de pétulance, je les exprimais sous cette forme nouvelle : Je suis sauvé, — je suis sauvé ; — oui, — pourvu que je ne sois pas assez sot pour confesser moi-même mon cas ! À peine avais-je prononcé ces paroles, que je sentis un froid de glace filtrer jusqu’à mon cœur. J’avais acquis quelque expérience de ces accès de perversité (dont je n’ai pas sans peine expliqué la singulière nature), et je me rappelais fort bien que dans aucun cas je n’avais su résister à ces victorieuses attaques. Et maintenant cette suggestion fortuite, venant de moi-même, — que je pourrais bien être assez sot pour confesser le meurtre dont je m’étais rendu coupable, — me confrontait comme l’ombre même de celui que j’avais assassiné, — et m’appelait vers la mort. D’abord, je fis un effort pour secouer ce cauchemar de mon âme. Je marchai vigoureusement, — plus vite, — toujours plus vite ; — à la longue je courus. J’éprouvais un désir enivrant de crier de toute ma force. Chaque flot successif de ma pensée m’accablait d’une nouvelle terreur ; car, hélas ! je comprenais bien, trop bien, que penser, dans ma situation, c’était me perdre. J’accélérai encore ma course, je bondissais comme un fou à travers les rues encombrées de monde. À la longue, la populace prit l’alarme et courut après moi. Je sentis alors la consommation de ma destinée. Si j’avais pu m’arracher la langue, je l’eusse fait ; — mais une voix rude résonna dans mes oreilles, — une main plus rude encore m’empoigna par l’épaule. Je me retournai, j’ouvris la bouche pour aspirer. Pendant un moment, j’éprouvai toutes les angoisses de la suffocation ; je devins aveugle, sourd, ivre ; et alors quelque démon invisible, pensai-je, me frappa dans le dos avec sa large main. Le secret si longtemps emprisonné s’élança de mon âme. On dit que je parlai, que je m’énonçai très distinctement, mais avec une énergie marquée et une ardente précipitation, comme si je craignais d’être interrompu avant d’avoir achevé les phrases brèves, mais grosses d’importance, qui me livraient au bourreau et à l’enfer. Ayant relaté tout ce qui était nécessaire pour la pleine conviction de la justice, je tombai terrassé, évanoui. Mais pourquoi en dirais-je plus ? Aujourd’hui je porte ces chaînes, et suis ici ! Demain, je serai libre ! — mais où ? Il y avait une fois un vieillard qui vivait avec sa vieille femme. Une fois, la vieille, en hachant des choux, se coupa le petit doigt ; elle l’arracha et le jeta derrière le poêle. Tout à coup, elle entendit une voix humaine parler derrière le poêle :
— Mère, mère, ôte-moi de là ! Elle fut étonnée, fit le signe de la croix, et demanda : — Qui donc es-tu ? — C’est moi, ton fils ; je suis né de ton petit doigt. La vieille le prit et le regarda. C’était un petit, tout petit enfant. On le distinguait à peine. Elle l’appela le petit Poucet. — Et où est mon père ? demanda le petit Poucet. — Il est allé aux champs. — J’irai le trouver et l’aider. Il arriva aux champs. — Dieu te soit en aide, petit père ! Le vieillard regarda autour de lui. — Quel miracle ! pensa-t-il. J’entends une voix d’homme, et je ne vois personne. Qui donc me parle ? — C’est moi, ton fils. — Mais je n’ai pas de fils. — Je viens seulement de naître ; ma mère, en coupant des choux, s’est coupé le petit doigt et l’a jeté derrière le poêle. C’est ainsi que je suis né, moi, le petit Poucet. Je suis venu t’aider à labourer la terre. Assieds-toi, père, mange ce que Dieu t’a envoyé, et repose-toi un peu. Le vieillard se réjouit et se mit à manger. Le petit Poucet monta dans l’oreille du cheval et se mit à labourer la terre. Mais d’abord il dit à son père : — Si l’on te demande à m’acheter, vends-moi sans crainte. Je ne me perdrai pas, et je reviendrai à la maison. Un seigneur vient à passer ; il regarde et s’étonne : le cheval marche, la charrue laboure, et personne ne les conduit. — On n’a jamais vu, jamais on n’a entendu dire qu’un cheval labourât de lui-même. — Serais-tu aveugle ? répond le paysan. C’est mon fils qui laboure. — Vends-le-moi. — Non, je ne le vendrai point ; c’est notre seule joie à sa mère et à moi, notre seule consolation. — Vends-le-moi, vieillard. — Eh bien ! donne mille roubles, et tu l’auras. — Quoi ? si cher ? — Tu vois, l’enfant est petit, mais vaillant, léger des pieds et prompt à faire les commissions. Le seigneur paya les mille roubles, mit le petit dans sa poche, et s’en alla chez lui. Mais le petit Poucet s’ennuya dans la poche, y fit un trou et s’échappa. Il marcha, marcha ; la nuit sombre le surprit ; il se cacha sous une touffe d’herbe et se mit à dormir. Vinrent à passer trois voleurs. — Salut, braves gens, dit le petit Poucet. Où allez-vous ? — Chez le pope. — Pour quoi faire ? — Voler des taureaux. — Prenez-moi avec vous. — À quoi es-tu bon ? Il nous faut un gaillard vigoureux et capable de faire un bon coup. — Parfaitement. Je passerai sous la porte, et je vous l’ouvrirai. — Ah ! ceci est autre chose ; viens avec nous. Ils partirent tous les quatre chez le pope ; le petit Poucet passa sous la porte, l’ouvrit, et dit : — Frères, restez ici ; je me glisserai dans l’étable, je choisirai le meilleur taureau, et je vous l’amènerai. Et il choisit en effet le plus beau et l’amena ; on l’entraîna dans les bois ; les voleurs le tuèrent, l’écorchèrent, et se partagèrent la viande. — Donnez-moi les tripes, dit le petit Poucet ; cela me suffira. Il les prit et se coucha dedans. Les voleurs après s’être partagé la viande, retournèrent chez eux. Survint un loup affamé ; il avala les tripes et le petit ; le voilà assis tout vivant dans le ventre du loup, et il n’était pas mal à son aise. Mais le loup eut mauvaise chance. Il aperçoit un troupeau en train de paître. Le berger dort ; maître loup se glisse et emporte une brebis. Mais le petit Poucet se met à crier à gorge déployée. — Berger ! âme de mouton ! tu dors, et le loup emporte une brebis. Le berger s’éveille, se jette sur le loup avec une trique, lâche sur lui ses chiens ; ils le déchirent à belles dents ; ses poils volent par touffes, et le loup se met à fuir. Mais il ne pouvait plus manger ; il maigrissait ; il serait mort de faim. Il supplie le petit Poucet de s’en aller. — Amène-moi chez mon père et ma mère, et je sortirai. Le loup court au village, se précipite dans la cabane du vieillard. Le petit Poucet sort du loup par le derrière, saisit sa queue et s’écrie : — Tuez le loup, tuez le loup gris ! Le vieillard saisit un gourdin, sa femme un autre, et ils se mirent à taper sur le loup ; ils le tuèrent, prirent sa peau et en firent un manteau pour le petit Poucet ; et ils vécurent longtemps. L'habitacle était sinistre.
C'était la noire misère parisienne attifée de son mensonge, l'odieux bric-à-brac d'une ancienne ancienne d'ouvriers bourgeois lentement démeublés par la noce et les fringales. D'abord un grand lit napoléonien qui avait pu être beau en 1810, mais dont les cuivres dédorés depuis les Cent-Jours, le vernis absent, les roulettes percluses, les pieds eux-mêmes lamentablement rapiécés et les éraflures sans nombre attestaient la décrépitude. Cette couche sans délices, à peine garnie d'un matelas équivoque et d'une paire de draps sales inhabilement dissimulés sous une courte-pointe gélatineuse, avait dû crever sous elle trois générations de déménageurs. Dans l'ombre de ce monument, qui remplissait le tiers de la mansarde, s'apercevait un autre matelas moucheté par les punaises et noir de crasse, étalé simplement sur le carreau. De l'autre côté, un vieux voltaire, qu'on pouvait croire échappé au sac d'une ville, laissait émigrer ses entrailles de varech et de fil de fer, malgré l'hypocrisie presque aimable d'une loque de tapisserie d'enfant. Auprès de ce meuble, que tous les fripiers avaient refusé d'acquérir, apparaissait, surmontée de son pot à eau et de sa cuvette, une de ces tables minuscules de crapuleux garnos qui font penser au Jugement dernier. Enfin, au-devant de l'unique fenêtre, une autre table ronde en noyer, sans luxe ni équilibre, que le frottement le plus assidu n'aurait pas fait resplendir, et trois chaises de paille, dont deux presque entièrement défoncées. Le linge, s'il en restait, devait se fourrer dans une vieille malle poilue et cadenassée sur laquelle s'asseyaient parfois les visiteurs. Tel était le mobilier, assez semblable à beaucoup d'autres, dans cette joyeuse capitale de la bamboche et du désarroi. Mais ce qu'il y avait de particulier et d'atroce, c'était la prétention de dignité fière et de distinction que l'habitante du lieu, madame Demandon, avait répandue, comme une pommade, sur la moisissure de cet effroyable taudis. La cheminée sans feu ni cendres eût pu être mélancolique, malgré sa hideur, sans le grotesque encombrement de souvenirs et de bibelots infâmes qui la surchargeaient. On y remarquait de petits globes cylindriques protégeant de petits bouquets de fleurs desséchées; un autre petit globe sphérique monté sur une rocaille en béton conchylifère, où le spectateur voyait flotter un paysage de la Suisse allemande; un assortiment de ces coquillages univalves dans lesquels une oreille poétique peut aisément percevoir le murmure lointain des flots; et deux de ces tendres bergers de Florian, mâle et femelle, en porcelaine coloriée, cuits pour la multitude, on ne sait dans quelles manufactures d'ignominie. A côté de ces oeuvres d'art se nichaient des images de dévotion, des colombes qui buvaient dans des calices d'or, des anges portant à brassées le "froment des élus", des premiers communiants très frisés tenant des cierges dans du papier à dentelle, puis deux ou trois questions du jour : "où est le chat?" "où est le garde-champêtre?" inexplicablement encadrées. Enfin des photographies d'ouvriers, des militaires ou de négociants. Le nombre était incroyable de ces effigies qui montaient en pyramide jusqu'au plafond. Çà et là, le long des murs, dans les intervalles des guenilles, quelques effrayantes chromolithographies, achetées aux foires ou délivrées par les magasins de confection, étaient appendues. La sentimentale Demandon raffolait de ces horreurs. Cette gueuse minaudière était une des plus décourageantes incarnations de l'idiote vanité des femmes, et la carie de cet "os surnuméraire", suivant l'expression de Bossuet, aurait fait reculer la peste. ...malgré ce déluge torrentiel, le malheureux garçon restait immobile sur son banc, sans bouger le moins du monde. L’eau coulait et ruisselait par toutes les gouttières; on entendait du côté de la ville le bruit grondant des voitures; à droite et à gauche des gens aux manteaux relevés partaient en courant; tout ce qui était vivant se faisait petit, s’enfuyait craintivement, cherchant un refuge; partout chez l’homme et chez la bête on sentait la peur de l’élément déchaîné, – seul ce noir peloton humain là sur son banc ne bougeait pas d’un pouce.
Je vous ai déjà dit que cet homme possédait le pouvoir magique d’exprimer ses sentiments par le mouvement et par le geste; mais rien, rien sur terre n’aurait pu rendre ce désespoir, cet abandon absolu de sa personne, cette mort vivante, d’une manière aussi saisissante que cette immobilité, cette façon de rester assis là, inerte et insensible sous la pluie battante, cette lassitude trop grande pour se lever et faire les quelques pas nécessaires afin de se mettre sous un abri quelconque, cette indifférence suprême à l’égard de sa propre existence. Aucun sculpteur, aucun poète, ni Michel-Ange, ni Dante, ne m’a jamais fait comprendre le geste du désespoir suprême, la misère suprême de la terre d’une façon aussi émouvante et aussi puissante que cet être vivant qui se laissait inonder par l’ouragan, – déjà trop indifférent, trop fatigué pour se garantir par un seul mouvement. Le soir, il alla voir dans les musicos les matelots danser avec leurs maîtresses; toutes avaient d’admirables cheveux noirs vernis et brillants comme l’aile du corbeau; une fort jolie créole vint même s’asseoir près de lui et trempa familièrement ses lèvres dans son verre, suivant la coutume du pays, et essaya de lier conversation avec lui en fort bon espagnol, car elle était de La Havane; elle avait des yeux d’un noir si velouté, un teint d’une pâleur si chaude et si dorée, un si petit pied, une taille si mince, que Tiburce, exaspéré, l’envoya à tous les diables, ce qui surprit fort la pauvre créature, peu accoutumée à un pareil accueil.
Parfaitement insensible aux perfections brunes des danseuses, Tiburce se retira à son hôtel des Armes du Brabant. Il se déshabilla fort mécontent, et, en s’entortillant de son mieux dans ces serviettes ouvrées qui servent de draps en Flandre, il ne tarda pas à s’endormir du sommeil des justes. Il fit les rêves les plus blonds du monde. Les nymphes et les figures allégoriques de la galerie de Médicis dans le déshabillé le plus galant vinrent lui faire une visite nocturne; elles le regardaient tendrement avec leurs larges prunelles azurées, et lui souriaient, de l’air le plus amical du monde, de leurs lèvres épanouies comme des fleurs rouges dans la blancheur de lait de leurs figures rondes et potelées. --L’un d’elles, la Néréide du tableau du Voyage de la reine, poussait la familiarité jusqu’à passer dans les cheveux du dormeur éperdu d’amour ses jolis doigts effilés enluminés de carmin. Une draperie de brocart ramagé cachait fort adroitement la difformité de ses jambes squameuses terminées en queue fourchue; ses cheveux blonds étaient coiffés d’algues et de corail, comme il sied à une fille de la mer; elle était adorable ainsi. Des groupes d’enfants joufflus et vermeils comme des roses nageaient dans une atmosphère lumineuse soutenant des guirlandes de fleurs d’un éclat insoutenable, et faisaient descendre du ciel une pluie parfumée. A un signe que fit la Néréide, les nymphes se mirent sur deux rangs et nouèrent ensemble le bout de leurs longues chevelures rousses, de façon à former une espèce de hamac en filigrane d’or pour l’heureux Tiburce et sa maîtresse à nageoires de poisson; ils s’y placèrent en effet, et les nymphes les balançaient en remuant légèrement la tête sur un rythme d’une douceur infinie. Tout à coup un bruit sec se fit entendre, les fils d’or se rompirent, Tiburce roula par terre. Tiburce était réellement un jeune homme fort singulier. sa bizarrerie avait surtout l’avantage de n’être pas affectée, il ne la quittait pas comme son chapeau et ses gants en rentrant chez lui: il était original entre quatre murs, sans spectateurs, pour lui tout seul.
N’allez pas croire, je vous prie, que Tiburce fût ridicule, et qu’il eût une de ces manies agressives, insupportables à tout le monde; il ne mangeait pas d’araignées, ne jouait d’aucun instrument et ne lisait de vers à personne; c’était un garçon posé, tranquille, parlant peu, écoutant moins, et dont l’œil à demi ouvert semblait regarder en dedans. Il vivait accroupi sur le coin d’un divan, étayé de chaque côté par une pile de coussins, s’inquiétant aussi peu des affaires du temps que de ce qui se passe dans la lune. - Il y avait très peu de substantifs qui fissent de l’effet sur lui, et jamais personne ne fut moins sensible aux grands mots. Il ne tenait en aucune façon à ses droits politiques et pensait que le peuple est toujours libre au cabaret. Ses idées sur toutes choses étaient fort simples: il aimait mieux ne rien faire que de travailler; il préférait le bon vin à la piquette, et une belle femme à une laide; en histoire naturelle, il avait une classification on ne peut plus succincte: ce qui se mange et ce qui ne se mange pas.—Il était d’ailleurs parfaitement détaché de toute chose humaine, et tellement raisonnable qu’il paraissait fou. Il n’avait pas le moindre amour-propre; il ne se croyait pas le pivot de la création, et comprenait fort bien que la terre pouvait tourner sans qu’il s’en mêlât; il ne s’estimait pas beaucoup plus que l’acarus du fromage ou les anguilles du vinaigre; en face de l’éternité et de l’infini, il ne se sentait pas le courage d’être vaniteux; ayant quelquefois regardé par le microscope et le télescope, il ne s’exagérait pas l’importance humaine; sa taille était de cinq pieds quatre pouces, mais il se disait que les habitants du soleil pouvaient bien avoir huit cents lieues de haut. Tel était notre ami Tiburce. – Un autre délice, le plus grand de tous vous attend.
– Eh ! lequel ? – Vous serez aimée ! – Par qui ? – Par moi ! Si vous ne me jugez pas indigne de prétendre à votre tendresse... – Vous êtes un prince de bonne mine, et votre habit vous va fort bien. – .... Si vous daignez ne pas repousser mes vœux, je vous donnerai tout mon cœur, comme un autre royaume dont vous serez la souveraine, et je ne cesserai jamais d'être l'esclave reconnaissant de vos cruels caprices. – Ah ! quel bonheur vous me promettez ! – Levez-vous donc, chère âme, et suivez-moi. – Vous suivre ? déjà ? Attendez un peu. Il y a sans doute plus d'une chose tentante parmi tout ce que vous m'offrez, mais savez-vous si, pour l'obtenir, il ne me faudrait pas quitter mieux ? – Que voulez-vous dire, princesse ? – Je dors depuis un siècle, c'est vrai, mais, depuis un siècle, je rêve. Je suis reine aussi, dans mes songes, et de quel divin royaume ! Mon palais a des murs de lumière; j'ai pour courtisans des anges qui me célèbrent en des musiques d'une douceur infinie, je marche sur des jonchées d'étoiles. Si vous saviez de quelles belles robes je m'habille, et les fruits sans pareils que l'on met sur ma table, et les vins de miel où je trempe mes lèvres ! Pour ce qui est de l'amour, croyez bien qu'il ne me fait pas défaut; car je suis adorée par un époux plus beau que tous les princes du monde et fidèle depuis cent ans. Tout bien considéré, monseigneur, je crois que je ne gagnerais rien à sortir de mon enchantement; je vous prie de me laisser dormir. Puis, il y eut une minute de tragique silence, une longue minute de prostration ; ce silence de mort, cette prostration des êtres et des choses qui succèdent aux fracas des grands écroulements, au tonnerre des grands cataclysmes… Et la lanterne, balancée dans les mains de Joseph, promenait sur tout cela, sur les visages morts et sur les caisses éventrées, une lueur rouge, tremblante, sinistre…
J’étais descendue, en même temps que les maîtres, à l’appel de Joseph. Devant ce désastre, et malgré le comique prodigieux de ces visages, mon premier sentiment avait été de la compassion. Il semblait que ce malheur m’atteignît, moi aussi, que je fusse de la famille pour en partager les épreuves et les douleurs. J’aurais voulu dire des paroles consolatrices à Madame dont l’attitude affaissée me faisait peine à voir… Mais cette impression de solidarité ou de servitude s’effaça vite. Le crime a quelque chose de violent, de solennel, de justicier, de religieux, qui m’épouvante certes, mais qui me laisse aussi — je ne sais comment exprimer cela — de l’admiration. Non, pas de l’admiration, puisque l’admiration est un sentiment moral, une exaltation spirituelle, et ce que je ressens n’influence, n’exalte que ma chair… C’est comme une brutale secousse, dans tout mon être physique, à la fois pénible et délicieuse, un viol douloureux et pâmé de mon sexe… C’est curieux, c’est particulier, sans doute, c’est peut-être horrible, — et je ne puis expliquer la cause véritable de ces sensations étranges et fortes, — mais chez moi, tout crime, — le meurtre principalement, — a des correspondances secrètes avec l’amour… Eh bien, oui, là !… un beau crime m’empoigne comme un beau mâle… Je dois dire qu’une réflexion que je fis transforma subitement en gaîté rigoleuse, en contentement gamin, cette grave, atroce et puissante jouissance du crime, laquelle succédait au mouvement de pitié qui, tout d’abord, avait alarmé mon cœur ; bien mal à propos… Je pensai : — Voici deux êtres qui vivent comme des taupes, comme des larves… Ainsi que des prisonniers volontaires, ils se sont volontairement enfermés dans la geôle de ces murs inhospitaliers… Tout ce qui fait la joie de la vie, le sourire de la maison, ils le suppriment comme du superflu. Ce qui pourrait être l’excuse de leur richesse, le pardon de leur inutilité humaine, ils s’en gardent comme d’une saleté. Ils ne laissent rien tomber de leur parcimonieuse table sur la faim des pauvres, rien tomber de leur cœur sec sur la douleur des souffrants. Ils économisent même sur le bonheur, leur bonheur à eux. Et je les plaindrais ?… Ah ! non… Ce qui leur arrive, c’est la justice. En les dépouillant d’une partie de leurs biens, en donnant de l’air aux trésors enfouis, les bons voleurs ont rétabli l’équilibre… Ce que je regrette, c’est qu’ils n’aient pas laissé ces deux êtres malfaisants, totalement nus et misérables, plus dénués que le vagabond qui, tant de fois, mendia vainement à leur porte, plus malades que l’abandonné qui agonise sur la route, à deux pas de ces richesses cachées et maudites. Cette idée que mes maîtres auraient pu, un bissac sur le dos, traîner leurs guenilles lamentables et leurs pieds saignants par la détresse des chemins, tendre la main au seuil implacable du mauvais riche, m’enchanta et me mit en gaîté. Mais la gaîté, je l’éprouvai plus directe et plus intense et plus haineuse, à considérer Madame, affalée près de ses caisses vides, plus morte que si elle eût été vraiment morte, car elle avait conscience de cette mort, et cette mort, on ne pouvait en concevoir une plus horrible, pour un être qui n’avait jamais rien aimé, rien que l’évaluation en argent de ces choses inévaluables que sont nos plaisirs, nos caprices, nos charités, notre amour, ce luxe divin des âmes… Cette douleur honteuse, ce crapuleux abattement, c’était aussi la revanche des humiliations, des duretés que j’avais subies, qui me venaient d’elle, à chaque parole sortant de sa bouche, à chaque regard tombant de ses yeux… J’en goûtai, pleinement, la jouissance délicieusement farouche. J’aurais voulu crier : « C’est bien fait… c’est bien fait ! » Et surtout j’aurais voulu connaître ces admirables et sublimes voleurs, pour les remercier, au nom de tous les gueux… et pour les embrasser, comme des frères… Ô bons voleurs, chères figures de justice et de pitié, par quelle suite de sensations fortes et savoureuses vous m’avez fait passer ! Tous les objets étaient à la place où la comtesse les avait laissés la veille. La Mort, subite, avait
foudroyé. La nuit dernière, sa bien−aimée s'était évanouie en des joies si profondes, s'était perdue en de si exquises étreintes, que son coeur, brisé de délices, avait défailli : ses lèvres s'étaient brusquement mouillées d'une pourpre mortelle. A peine avait−elle eu le temps de donner à son époux un baiser d'adieu, en souriant, sans une parole : puis ses longs cils, comme des voiles de deuil, s'étaient abaissés sur la belle nuit de ses yeux. La journée sans nom était passée. Vers midi, le comte d'Athol, après l'affreuse cérémonie du caveau familial, avait congédié au cimetière la noire escorte. Puis, se renfermant, seul, avec l'ensevelie, entre les quatre murs de marbre, il avait tiré sur lui la porte de fer du mausolée. − De l'encens brûlait sur un trépied, devant le cercueil ; − une couronne lumineuse de lampes, au chevet de la jeune défunte, l'étoilait. Lui, debout, songeur, avec l'unique sentiment d'une tendresse sans espérance, était demeuré là, tout le jour. Sur les six heures, au crépuscule, il était sorti du lieu sacré. En renfermant le sépulcre, il avait arraché de la serrure la clef d'argent, et, se haussant sur la dernière marche du seuil, il l'avait jetée doucement dans l'intérieur du tombeau. Il l'avait lancée sur les dalles intérieures par le trèfle qui surmontait le portail. − Pourquoi ceci ? ... A coup sûr d'après quelque résolution mystérieuse de ne plus revenir. Et maintenant il revoyait la chambre veuve. La croisée, sous les vastes draperies de cachemire mauve broché d'or, était ouverte : un dernier rayon du soir illuminait, dans un cadre de bois ancien, le grand portrait de la trépassée. Le comte regarda, autour de lui, la robe jetée, la veille, sur un fauteuil ; sur la cheminée, les bijoux, le collier de perles, l'éventail à demi fermé, les lourds flacons de parfums qu'Elle ne respirerait plus. Sur le lit d'ébène aux colonnes tordues, resté défait, auprès de l'oreiller où la place de la tête adorée et divine était visible encore au milieu des dentelles, il aperçut le mouchoir rougi de gouttes de sang où sa jeune âme avait battu de l'aile un instant ; le piano ouvert, supportant une mélodie inachevée à jamais ; les fleurs indiennes cueillies par elle, dans la serre, et qui se mouraient dans de vieux vases de Saxe ; et, au pied du lit, sur une fourrure noire, les petites mules de velours oriental, sur lesquelles une devise rieuse de Véra brillait, brodée en perles : Qui verra Véra l'aimera. Les pieds nus de la bien−aimée y jouaient hier matin, baisés, à chaque pas, par le duvet des cygnes ! − Et là, là, dans l'ombre, la pendule, dont il avait brisé le ressort pour qu'elle ne sonnât plus d'autres heures. Ainsi elle était partie ! ... Où donc ! ... Vivre maintenant ? − Pour quoi faire ? ... C'était impossible, absurde.
De grands paysages secrets, intimes comme le rêve, sans cesse tournoyaient et se volatilisaient sur elle comme l'encens léger des nuages sur la flèche incandescente d'une cime. Sa venue était pareille à la face de lumière d'une forêt contemplée d'une tour, au soleil qu'exténuent les brouillards d'une côte pluvieuse, au chant fortifiant de la trompette sur les plages agrandies du matin. Près d'elle j'ai rêvé parfois d'un cavalier barbare, au bonnet pointu, à califourchon sur son cheval nain comme sur une raide chaise d'église, tout seul et minuscule d'un trot de jouet mécanique à travers les steppes de la Mongolie - et d'autres fois c'était quelque vieil empereur bulgaroctone, pareil à une châsse parcheminée entrant dans Sainte-Sophie pour les actions de grâces, pendant que sous l'herbe des siècles sombre le pavé couleur d'os de Byzance et que l'orgasme surhumain des trompettes tétanise le soleil couchant.
Je l'ai tuée. Je l'ai tuée et, alors qu'elle gisait comme une masse inerte et plate, près de la fenêtre derrière laquelle luisait le champ mort, j'ai posé le pied sur son cadavre et j'ai éclaté de rire. Ce n'était pas le rire d'un fou, oh non ! Je riais parce que ma poitrine respirait d'un souffle régulier et léger, parce qu'à l'intérieur, je me sentais gai, calme et vide; le ver qui me rongeait le coeur avait disparu. Je me suis penché et j'ai regardé ses yeux morts. Immenses, avides de lumière, ils étaient restés ouverts et ressemblaient aux yeux d'une poupée de cire, ils étaient aussi ronds et aussi ternes, comme recouverts de mica. Je pouvais les toucher avec mon doigt, les ouvrir et les fermer, et je n'éprouvais aucune peur, car dans leur pupille noire et impénétrable, il n'y avait plus le démon du mensonge et du doute, qui s'était si longtemps, avec tant de voracité, abreuvé de mon sang.
Quand on m'a arrêté, je riais, et les gens qui m'ont arrêté ont trouvé cela effrayant et monstrueux. Les uns se détournaient de moi avec répulsion et prenaient leurs distances; d'autres s'avançaient droit sur moi, menaçants, des reproches aux lèvres, mais quand leurs yeux rencontraient mon regard clair et joyeux, leurs visages blêmissaient et ils restaient cloués sur place. - C'est un fou ! disaient-ils, et j'avais l'impression que ce mot les réconfortait, car il les aidait à comprendre l'énigme : comment moi, un homme amoureux, j'avais pu tuer celle que j'aimais, et en rire. Seul un gros homme rubicond et jovial employa un autre mot, un mot qui me cingla et éclipsa soudain la lumière : - Pauvre homme ! dit-il avec compassion et sans hargne, parce qu'il était gros et jovial. Le pauvre ! - Non ! m'écriai-je. Je vous interdis de dire ça ! Je ne sais pourquoi je me suis jeté sur lui. Bien sûr, je ne voulais pas le tuer ni lui faire du mal, mais tous ces gens terrorisés, qui voyaient en moi un fou et un criminel, ont eu encore plus peur et se sont mis à pousser de tels cris, que j'ai recommencé à rire. Quand on m'a sorti de la pièce où se trouvait le cadavre, je répétais d'une voix forte, avec insistance, en regardant le gros homme jovial : - Je suis heureux ! Je suis heureux ! Et c'était vrai. - Vous n'avez pas le droit de rire !
Lorsqu'elle fut calmée, je continuai à lui parler de mon amour à voix basse. Jamais je n'avais parlé aussi bien, car jamais je n'avais aimé aussi fort. Je parlai des tourments de l'attente, des larmes empoisonnées de l'angoisse et d'une jalousie folle, de mon âme, qui n'était qu'amour. Et je vis ses cils se baisser, projetant une ombre épaisse sur ses joues pâles. Je vis sourdre sous leur blancheur mate la lueur rose d'un feu qui s'allumait, je sentis son corps souple ployer instinctivement vers moi...Elle était déguisée en déesse de la nuit et, mystérieuse comme les ténèbres, revêtue de dentelle noire, scintillant de tous les diamants de ses étoiles, elle était belle comme le rêve oublié d'une lointaine enfance. Je parlais, et mes yeux se remplissaient de larmes, mon cœur palpitait de joie. Et enfin, je vis, je vis ses lèvres s'entrouvrir en un doux sourire attendri, ses cils se soulever en frémissant. Lentement, craintivement, avec une infinie confiance, elle tourna la tête vers moi et... Jamais je n'avais entendu un rire pareil ! - Non, non, je ne peux pas...fit-elle en gémissant presque et, renversant la tête en arrière, elle partit de nouveau d'une cascade de rire sonore. Ah, si l'on m'avait donné, rien qu'une minute, un visage humain ! Je me mordais les lèvres, les larmes coulaient sur mon visage en feu, et cette physionomie stupide, où tout était à sa place, le nez, les yeux et les lèvres, affichait une indifférence inébranlable et terrible de son absurdité. Quand je sortis en titubant sur mes jambes multicolores, je fus longtemps poursuivi par son rire retentissant, tel un filet d'eau argenté tombant d'une hauteur immense et s'écrasant avec un chant joyeux sur une roche dure. Les yeux fermés sous les feuilles fraîches de ses troènes, le chemin d'eau m'emportait chaque après-midi à reculons comme une Ophélie passée dans sa bouée de fleurs, dissolvant lentement du front les clôtures molles. Couché plus bas qu'aucune autre créature vivante sur l'oreiller fondamental, tombait sur moi la face des arbres comme la rosée d'un visage penché sur un lit de malade, et mettant le monde doucement à flot sur ma route comme un liège, j'étais fiancé aux anneaux sonores des ponts comme une gaze, de plain pied avec le mufle bénin des vaches. L'ombre de la forêt sur la rivière mêlait à l'eau noire une douce tisane de feuilles mortes et d'oubli. Midi me trouvait dérivant au large ensoleillé de vastes grèves scintillantes, les mains closes sur le cœur, les paupières éclatantes de langueur, puis le somptueux froissement des roseaux dévorait les rives d'une palissade théâtrale de murmures, et mollement entravé comme d'une robe par les tiges aux longues traînes, engourdi au fond d'une impasse verte, les doux maillons de soleil de l'eau qui me portait comme un ventre, comme un qui regarde au fond d'un puits redescendaient jusqu'à moi en se dénouant sur le visage d'une femme.
La Biblioteca de Babel
El universo (que otros llaman la Biblioteca) se compone de un número indefinido, y tal vez infinito, de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores: interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. Veinte anaqueles, a cinco largos anaqueles por lado, cubren todos los lados menos dos; su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da a un angosto zaguán, que desemboca en otra galería, idéntica a la primera y a todas. A izquierda y a derecha del zaguán hay dos gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie; otro, satisfacer las necesidades finales. Por ahí pasa la escalera espiral, que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En el zaguán hay un espejo, que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que la Biblioteca no es infinita (si lo fuera realmente ¿a qué esa duplicación ilusoria?); yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito... La luz procede de unas frutas esféricas que llevan el nombre de lámparas. Hay dos en cada hexágono: transversales. La luz que emiten es insuficiente, incesante. Como todos los hombres de la Biblioteca, he viajado en mi juventud; he peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos; ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací. Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda; mi sepultura será el aire insondable; mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída, que es infinita. Yo afirmo que la Biblioteca es interminable. Los idealistas arguyen que las salas hexagonales son una forma necesaria del espacio absoluto o, por lo menos, de nuestra intuición del espacio. Razonan que es inconcebible una sala triangular o pentagonal. (Los místicos pretenden que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro circular de lomo continuo, que da toda la vuelta de las paredes; pero su testimonio es sospechoso; sus palabras, oscuras. Ese libro cíclico es Dios.) Básteme, por ahora, repetir el dictamen clásico: La Biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible. A cada uno de los muros de cada hexágono corresponden cinco anaqueles; cada anaquel encierra treinta y dos libros de formato uniforme; cada libro es de cuatrocientas diez páginas; cada página, de cuarenta renglones; cada renglón, de unas ochenta letras de color negro. También hay letras en el dorso de cada libro; esas letras no indican o prefiguran lo que dirán las páginas. Sé que esa inconexión, alguna vez, pareció misteriosa. Antes de resumir la solución (cuyo descubrimiento, a pesar de sus trágicas proyecciones, es quizá el hecho capital de la historia) quiero rememorar algunos axiomas. El primero: La Biblioteca existe ab alterno. De esa verdad cuyo colorario inmediato es la eternidad futura del mundo, ninguna mente razonable puede dudar. El hombre, el imperfecto bibliotecario, puede ser obra del azar o de los demiurgos malévolos; el universo, con su elegante dotación de anaqueles, de tomos enigmáticos, de infatigables escaleras para el viajero y de letrinas para el bibliotecario sentado, sólo puede ser obra de un dios. Para percibir la distancia que hay entre lo divino y lo humano, basta comparar estos rudos símbolos trémulos que mi falible mano garabatea en la tapa de un libro, con las letras orgánicas del interior: puntuales, delicadas, negrísimas, inimitablemente simétricas. El segundo: El número de símbolos ortográficos es veinticinco. Esa comprobación permitió, hace trescientos años, formular una teoría general de la Biblioteca y resolver satisfactoriamente el problema que ninguna conjetura había descifrado: la naturaleza informe y caótica de casi todos los libros. Uno, que mi padre vio en un hexágono del circuito quince noventa y cuatro, constaba de las letras MCV perversamente repetidas desde el renglón primero hasta el último. Otro (muy consultado en esta zona) es un mero laberinto de letras, pero la página penúltima dice «Oh tiempo tus pirámides». Ya se sabe: por una línea razonable o una recta noticia hay leguas de insensatas cacofonías, de fárragos verbales y de incoherencias. (Yo sé de una región cerril cuyos bibliotecarios repudian la supersticiosa y vana costumbre de buscar sentido en los libros y la equiparan a la de buscarlo en los sueños o en las líneas caóticas de la mano... Admiten que los inventores de la escritura imitaron los veinticinco símbolos naturales, pero sostienen que esa aplicación es casual y que los libros nada significan en sí. Ese dictamen, ya veremos no es del todo falaz.) Durante mucho tiempo se creyó que esos libros impenetrables correspondían a lenguas pretéritas o remotas. Es verdad que los hombres más antiguos, los primeros bibliotecarios, usaban un lenguaje asaz diferente del que hablamos ahora; es verdad que unas millas a la derecha la lengua es dialectal y que noventa pisos más arriba, es incomprensible. Todo eso, lo repito, es verdad, pero cuatrocientas diez páginas de inalterables MCV no pueden corresponder a ningún idioma, por dialectal o rudimentario que sea. Algunos insinuaron que cada letra podía influir en la subsiguiente y que el valor de MCV en la tercera línea de la página 71 no era el que puede tener la misma serie en otra posición de otra página, pero esa vaga tesis no prosperó. Otros pensaron en criptografías; universalmente esa conjetura ha sido aceptada, aunque no en el sentido en que la formularon sus inventores. Hace quinientos años, el jefe de un hexágono superior dio con un libro tan confuso como los otros, pero que tenía casi dos hojas de líneas homogéneas. Mostró su hallazgo a un descifrador ambulante, que le dijo que estaban redactadas en portugués; otros le dijeron que en yiddish. Antes de un siglo pudo establecerse el idioma: un dialecto samoyedo-lituano del guaraní, con inflexiones de árabe clásico. También se descifró el contenido: nociones de análisis combinatorio, ilustradas por ejemplos de variaciones con repetición ilimitada. Esos ejemplos permitieron que un bibliotecario de genio descubriera la ley fundamental de la Biblioteca. Este pensador observó que todos los libros, por diversos que sean, constan de elementos iguales: el espacio, el punto, la coma, las veintidós letras del alfabeto. También alegó un hecho que todos los viajeros han confirmado: No hay en la vasta Biblioteca, dos libros idénticos. De esas premisas incontrovertibles dedujo que la Biblioteca es total y que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos (número, aunque vastísimo, no infinito) o sea todo lo que es dable expresar: en todos los idiomas. Todo: la historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la Biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos, la demostración de la falacia del catálogo verdadero, el evangelio gnóstico de Basilides, el comentario de ese evangelio, el comentario del comentario de ese evangelio, la relación verídica de tu muerte, la versión de cada libro a todas las lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos los libros, el tratado que Beda pudo escribir (y no escribió) sobre la mitología de los sajones, los libros perdidos de Tácito. Cuando se proclamó que la Biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera: en algún hexágono. El universo estaba justificado, el universo bruscamente usurpó las dimensiones ilimitadas de la esperanza. En aquel tiempo se habló mucho de las Vindicaciones: libros de apología y de profecía, que para siempre vindicaban los actos de cada hombre del universo y guardaban arcanos prodigiosos para su porvenir. Miles de codiciosos abandonaron el dulce hexágono natal y se lanzaron escaleras arriba, urgidos por el vano propósito de encontrar su Vindicación. Esos peregrinos disputaban en los corredores estrechos, proferían oscuras maldiciones, se estrangulaban en las escaleras divinas, arrojaban los libros engañosos al fondo de los túneles, morían despeñados por los hombres de regiones remotas. Otros se enloquecieron... Las Vindicaciones existen (yo he visto dos que se refieren a personas del porvenir, a personas acaso no imaginarias) pero los buscadores no recordaban que la posibilidad de que un hombre encuentre la suya, o alguna pérfida variación de la suya, es computable en cero. También se esperó entonces la aclaración de los misterios básicos de la humanidad: el origen de la Biblioteca y del tiempo. Es verosímil que esos graves misterios puedan explicarse en palabras: si no basta el lenguaje de los filósofos, la multiforme Biblioteca habrá producido el idioma inaudito que se requiere y los vocabularios y gramáticas de ese idioma. Hace ya cuatro siglos que los hombres fatigan los hexágonos... Hay buscadores oficiales, inquisidores. Yo los he visto en el desempeño de su función: llegan siempre rendidos; hablan de una escalera sin peldaños que casi los mató; hablan de galerías y de escaleras con el bibliotecario; alguna vez, toman el libro más cercano y lo hojean, en busca de palabras infames. Visiblemente, nadie espera descubrir nada. A la desaforada esperanza, sucedió, como es natural, una depresión excesiva. La certidumbre de que algún anaquel en algún hexágono encerraba libros preciosos y de que esos libros preciosos eran inaccesibles, pareció casi intolerable. Una secta blasfema sugirió que cesaran las buscas y que todos los hombres barajaran letras y símbolos, hasta construir, mediante un improbable don del azar, esos libros canónicos. Las autoridades se vieron obligadas a promulgar órdenes severas. La secta desapareció, pero en mi niñez he visto hombres viejos que largamente se ocultaban en las letrinas, con unos discos de metal en un cubilete prohibido, y débilmente remedaban el divino desorden. Otros, inversamente, creyeron que lo primordial era eliminar las obras inútiles. Invadían los hexágonos, exhibían credenciales no siempre falsas, hojeaban con fastidio un volumen y condenaban anaqueles enteros: a su furor higiénico, ascético, se debe la insensata perdición de millones de libros. Su nombre es execrado, pero quienes deploran los «tesoros» que su frenesí destruyó, negligen dos hechos notorios. Uno: la Biblioteca es tan enorme que toda reducción de origen humano resulta infinitesimal. Otro: cada ejemplar es único, irreemplazable, pero (como la Biblioteca es total) hay siempre varios centenares de miles de facsímiles imperfectos: de obras que no difieren sino por una letra o por una coma. Contra la opinión general, me atrevo a suponer que las consecuencias de las depredaciones cometidas por los Purificadores, han sido exageradas por el horror que esos fanáticos provocaron. Los urgía el delirio de conquistar los libros del Hexágono Carmesí: libros de formato menor que los naturales; omnipotentes, ilustrados y mágicos. También sabemos de otra superstición de aquel tiempo: la del Hombre del Libro. En algún anaquel de algún hexágono (razonaron los hombres) debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás: algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios. En el lenguaje de esta zona persisten aún vestigios del culto de ese funcionario remoto. Muchos peregrinaron en busca de Él. Durante un siglo fatigaron en vano los más diversos rumbos. ¿Cómo localizar el venerado hexágono secreto que lo hospedaba? Alguien propuso un método regresivo: Para localizar el libro A, consultar previamente un libro B que indique el sitio de A; para localizar el libro B, consultar previamente un libro C, y así hasta lo infinito... En aventuras de ésas, he prodigado y consumido mis años. No me parece inverosímil que en algún anaquel del universo haya un libro total; ruego a los dioses ignorados que un hombre - ¡uno solo, aunque sea, hace miles de años! - lo haya examinado y leído. Si el honor y la sabiduría y la felicidad no son para mí, que sean para otros. Que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. Que yo sea ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, en un ser, Tu enorme Biblioteca se justifique. Afirman los impíos que el disparate es normal en la Biblioteca y que lo razonable (y aun la humilde y pura coherencia) es una casi milagrosa excepción. Hablan (lo sé) de «la Biblioteca febril, cuyos azarosos volúmenes corren el incesante albur de cambiarse en otros y que todo lo afirman, lo niegan y lo confunden como una divinidad que delira». Esas palabras que no sólo denuncian el desorden sino que lo ejemplifican también, notoriamente prueban su gusto pésimo y su desesperada ignorancia. En efecto, la Biblioteca incluye todas las estructuras verbales, todas las variaciones que permiten los veinticinco símbolos ortográficos, pero no un solo disparate absoluto. Inútil observar que el mejor volumen de los muchos hexágonos que administro se titula «Trueno peinado», y otro «El calambre de yeso» y otro «Axaxaxas mlo». Esas proposiciones, a primera vista incoherentes, sin duda son capaces de una justificación criptográfica o alegórica; esa justificación es verbal y, ex hypothesi, ya figura en la Biblioteca. No puedo combinar unos caracteres dhcmrlchtdj que la divina Biblioteca no haya previsto y que en alguna de sus lenguas secretas no encierren un terrible sentido. Nadie puede articular una sílaba que no esté llena de ternuras y de temores; que no sea en alguno de esos lenguajes el nombre poderoso de un dios. Hablar es incurrir en tautologías. Esta epístola inútil y palabrera ya existe en uno de los treinta volúmenes de los cinco anaqueles de uno de los incontables hexágonos, y también su refutación. (Un número n de lenguajes posibles usa el mismo vocabulario; en algunos, el símbolo biblioteca admite la correcta definición ubicuo y perdurable sistema de galerías hexagonales, pero biblioteca es pan o pirámide o cualquier otra cosa, y las siete palabras que la definen tienen otro valor. Tú, que me lees, ¿estás seguro de entender mi lenguaje?). La escritura metódica me distrae de la presente condición de los hombres. La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma. Yo conozco distritos en que los jóvenes se prosternan ante los libros y besan con barbarie las páginas, pero no saben descifrar una sola letra. Las epidemias, las discordias heréticas, las peregrinaciones que inevitablemente degeneran en bandolerismo, han diezmado la población. Creo haber mencionado los suicidios, cada año más frecuentes. Quizá me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana - la única - está por extinguirse y que la Biblioteca perdurará: iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta. Acabo de escribir infinita. No he interpolado ese adjetivo por una costumbre retórica; digo que no es ilógico pensar que el mundo es infinito. Quienes lo juzgan limitado, postulan que en lugares remotos los corredores y escaleras y hexágonos pueden inconcebiblemente cesar, lo cual es absurdo. Quienes la imaginan sin límites, olvidan que los tiene el número posible de libros. Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema: La biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden (que, repetido, sería un orden: el Orden). Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza. Les rendez-vous manqués d'amoureux au creux d'une carrière de porphyre, - la géhenne et la gigue démente des bateaux en feu, par une nuit de brume, sur la mer du Nord - les géantes broussailles de ronces et les hautes couronnes de cimetière d'une usine bombardée - ne pourraient donner qu'une faible idée de ce vide pailleté de brûlures, de ce vau-l'eau et de cette dérive d'épaves comme les hautes eaux de l'Amazone où mon esprit n'avait cessé de flotter après le départ, au milieu d'énigmatiques monosyllabes, de celle que je ne savais plus nommer que par des noms de glaciers inaccessibles ou de quelques-unes de ces splendides rivières mongoles aux roseaux chanteurs, aux tigres blancs et odorants, à la tendresse d'oasis inutiles au milieu des cailloutis brûlés des steppes, ces rivières qui défilent si doucement devant le chant d'un oiseau perdu à la cime d'un roseau, comme posé après un retrait du déluge sur un paysage balayé des dernières touches de l'homme : Nonni, Kéroulèn, Sélenga. Nonni, c'est le nom que je lui donne dans ses consolations douces, ses grandes échappées de tendresse comme sous des voiles de couvent, c'est la douceur de caillou de ses mains sèches, sa petite sueur d'enfant, légère comme une rosée, après l'étreinte matinale, c'est la petite soeur des nuits innocentes comme des lis, la petite fille des jeux sages, des oreillers blancs comme un matin frais de septembre, - Kéroulèn, ce sont les orages rouges de ses muscles vaincus dans la fièvre, c'est sa bouche tordue de cette éclatante torsion sculpturale des poutrelles de fer après l'incendie, les grandes vagues vertes où flottent ses jambes houleuses entre les muscles frais de la mer quand je sombre avec elle comme une planche à travers des strates translucides et ce grand bruit de cloches secouées qui nous accompagne sur la couche des profondeurs, - Sélenga, c'est quand flotte sa robe comme un vol de mouettes ensoleillé au milieu des rues vides du matin, c'est dans de grands voiles battants, ocellés de ses yeux comme une queue d'oiseau à traîne, ce sont ses yeux liquides qui nagent autour d'elle comme une danse d'étoiles - c'est quand elle descend dans mes rêves par les cheminées calmes de décembre, s'assied près de mon lit et prend timidement ma main entre ses petits doigts pour le difficile passage à travers les paysages solennels de la nuit, et ses yeux transparents à toutes les comètes ouverts au-dessus de mes yeux jusqu'au matin.
Le plus grand nombre de ceux qui passaient avaient un maintien convaincu et propre aux affaires, et ne semblaient occupés qu'à se frayer un chemin à travers la foule.Ils fronçaient les sourcils et roulaient les yeux vivement; quand ils étaient bousculés par quelques passants voisins, ils ne montraient aucun symptôme d'impatience, mais rajustaient leurs vêtements et se dépêchaient. D'autres, une classe fort nombreuse encore, étaient inquiets dans leurs mouvements, avaient le sang à la figure, se parlaient à eux-mêmes et gesticulaient, comme s'ils se sentaient seuls par le fait même de la multitude innombrable qui les entourait. Quand ils étaient arrêtés dans leur marche, ces gens-là cessaient tout à coup de marmotter, mais redoublaient leurs gesticulations, et attendaient, avec un sourire distrait et exagéré, le passage des personnes qui leur faisaient obstacle. S'ils étaient poussés, ils saluaient abondamment les pousseurs, et paraissaient accablés de confusion. - Dans ces deux vastes classes d'hommes, au-delà de ce que je viens de noter, il n'y avait rien de bien caractéristique. Leurs vêtements appartenaient à cet ordre qui est exactement défini par le terme : décent. C'étaient indubitablement des gentilshommes, des marchands, des attorneys, des fournisseurs, des agioteurs, -les eupatrides et l'ordinaire banal de la société, -hommes de loisir et hommes activement engagés dans des affaires personnelles, et les conduisant sous leur propre responsabilité. Ils n'excitèrent pas chez moi une très grande attention.
La race des commis sautait aux yeux, et, là, je distinguai deux divisions remarquables. Il y avait les petits commis des maisons à esbroufe, - jeunes messieurs serrés dans leurs habits, les bottes brillantes, les cheveux pommadés et la lèvre insolente. En mettant les cheveux d'un côté un certain je ne sais quoi de fringant dans les manières qu'on pourrait définir genre calicot, faute d'un meilleur mot, le genre de ces individus me parut un exact fac-simile de ce qui avait été la perfection du bon ton douze ou dix-huit mois auparavant. Ils portaient les grâces de rebut de la gentry; -et cela, je crois, implique la meilleure définition de cette classe. Quant à la classe des premiers commis de maisons solides, ou des steady old fellows, il était impossible de s'y méprendre. On les reconnaissait à leurs habits et pantalons noirs ou bruns, d'une tournure confortable, à leurs cravates et à leurs gilets blancs, à leurs larges souliers d'apparence solide, avec des bas épais ou des guêtres. Ils avaient tous la tête légèrement chauve, et l'oreille droite, accoutumée dès longtemps à tenir la plume, avait contracté un singulier tic d'écartement. J'observai qu'ils ôtaient ou remettaient toujours leurs chapeaux avec les deux mains, et qu'ils portaient des montres avec de courtes chaînes d'or d'un modèle solide et ancien. Leur affectation, c'était la respectabilité, - si toutefois il peut y avoir une affectation aussi honorable. Il y avait bon nombre de ces individus d'une apparence brillante que je reconnus facilement pour appartenir à la race des filous de la haute pègre dont toutes les grandes villes sont infestées. J'étudiai très curieusement cette espèce de gentry, et je trouvai difficile de comprendre comment ils pouvaient être pris pour des gentlemen par les gentlemen eux-mêmes. L'exagération de leurs manchettes, avec un air de franchise, devait les trahir du premier coup. Les joueurs de profession - et j'en découvris un grand nombre- étaient encore plus aisément reconnaissables. Ils portaient toutes les espèces de toilettes, depuis celle du parfait maquereau, joueur de gobelets, au gilet de velours, à la cravate de fantaisie, aux chaînes de cuivre doré, aux boutons de filigrane, jusqu'à la toilette cléricale, si scrupuleusement simple, que rien n'était moins propre à éveiller le soupçon. Tous cependant se distinguaient par un teint cuit et basané, par je ne sais quel obscurcissement vaporeux de l’œil, par la compression et la pâleur de la lèvre. Il y avait, en outre, deux autres traits qui me les faisaient toujours deviner : un ton bas et réservé dans la conversation, et une disposition plus qu'ordinaire du pouce à s'étendre jusqu'à faire angle droit avec les doigts. -Très souvent, en compagnie de ces fripons, j'ai observé quelques hommes qui différaient un peu par leurs habitudes; cependant, c'étaient toujours des oiseaux de même plumage. On peut les définir : des gentlemen qui vivent de leur esprit. Ils se divisent, pour dévorer le public, en deux bataillons, - le genre dandy et le genre militaire. Dans la première classe, les caractères principaux sont longs cheveux et sourires; et dans la seconde, longues redingotes et froncements de sourcils. En descendant l'échelle de ce qu'on appelle gentility, je trouvai des sujets de méditation plus noirs et plus profonds. Je vis des colporteurs juifs avec des yeux de faucon étincelants dans des physionomies dont le reste n'était qu'abjecte humilité; de hardis mendiants de profession bousculant des pauvres d'un meilleur titre, que le désespoir seul avait jetés dans les ombres de la nuit pour implorer la charité; des invalides tout faibles et pareils à des spectres sur qui la mort avait placé une main sûre, et qui clopinaient et vacillaient à travers la foule, regardant chacun au visage avec des yeux pleins de prières, comme en quête de quelques consolation fortuite, de quelque espérance perdue; de modestes jeunes filles qui revenaient d'un labeur prolongé vers un sombre logis, et reculaient plus éplorées qu'indignées devant les œillades des drôles dont elles ne pouvaient même pas éviter le contact direct; des prostituées de toute sorte et de tout âge - l'incontestable beauté dans la primeur de sa féminéité, faisant rêver de la statue de Lucien dont la surface était de marbre de Paros et l'intérieur rempli d'ordures, - la lépreuse en haillons, dégoûtante et absolument déchue, - la vieille sorcière, ridée, peinte, plâtrée, chargée de bijouterie, faisant un dernier effort vers la jeunesse,- la pure enfant à la forme non mûre, mais déjà façonnée par une longue camaraderie aux épouvantables coquetteries de son commerce, et brûlant de l'ambition dévorante d'être rangée au niveau de ses aînées dans le vice; des ivrognes innombrables et indescriptibles, ceux-ci déguenillés, chancelants, désarticulés, avec le visage meurtri et les yeux ternes, - ceux-là avec leurs vêtements entiers, mais sales, une crânerie légèrement vacillante, de grosses lèvres sensuelles, des faces rubicondes et sincères, - d'autres vêtus d'étoffes qui jadis avaient été bonnes, et qui maintenant encore étaient scrupuleusement brossées, - des hommes qui marchaient d'un pas plus ferme et plus élastique que nature, mais dont les physionomies étaient terriblement pâles, les yeux atrocement effarés et rouges, et qui, tout en allant à grands pas à travers la foule, agrippaient avec des doigts tremblants tous les objets qui se trouvaient à leur portée; et puis des pâtissiers, des commissionnaires, des porteurs de charbon, des ramoneurs; des joueurs d'orgue, des montreurs de singes, des marchands de chansons, ceux qui vendaient avec ceux qui chantaient; des artisans déguenillés et des travailleurs de toute sorte épuisés à la peine, - et tous pleins d'une activité bruyante et désordonnée qui affligeait l'oreille par ses discordances et apportait à l’œil une sensation douloureuse. A mesure que la nuit devenait plus profonde, l'intérêt de la scène s'approfondissait aussi pour moi; car non seulement le caractère général de la foule était altéré (ses traits les plus nobles s'effaçant avec la retraite graduelle de la partie la plus sage de la population, et les plus grossiers venant plus rigoureusement en relief, à mesure que l'heure plus avancée tirait chaque espèce d'infamie de sa tanière), mais les rayons des becs de gaz, faibles d'abord quand ils luttaient avec le jour mourant, avaient maintenant pris le dessus et jetaient sur toutes choses une lumière étincelante et agitée. Tout était noir, mais éclatant - comme cette ébène à laquelle on a comparé le style de Tertullien. Mais lui, le peintre, mettait la gloire dans son œuvre, qui avançait d'heure en heure et de jour en jour. -Et c'était un homme passionné, et étrange, et pensif, qui se perdait en rêveries; si bien qu'il ne voulait pas voir que la lumière qui tombait si lugubrement dans cette tour isolée desséchait la santé et les esprits de sa femme, qui se languissait visiblement pour tout le monde, excepté pour lui. Cependant, elle souriait toujours, et toujours sans se plaindre, parce qu'elle voyait que le peintre (qui avait un grand renom) prenait un plaisir vif et brûlant dans sa tâche, et travaillait nuit et jour pour peindre celle qui l'aimait si fort, mais qui devenait de jour en jour plus languissante et plus faible. Et, en vérité, ceux qui contemplaient le portrait parlaient à voix basse de sa ressemblance, comme d'une puissante merveille et comme d'une preuve non moins grande de la puissance du peintre que son profond amour pour celle qu'il peignait si miraculeusement bien. - Mais, à la longue, comme la besogne approchait de sa fin, personne ne fut plus admis dans la tour; car le peintre était devenu fou par l'ardeur de son travail, et il détournait rarement les yeux de la toile, même pour regarder la figure de sa femme. Et il ne voulait pas voir que les couleurs qu'il étalait sur la toile étaient tirées des joues de celle qui était assise près de lui. Et quand bien des semaines furent passées et qu'il ne restait plus que peu de chose à faire, rien qu'une touche sur la bouche et un glacis sur l’œil, l'esprit de la dame palpita encore comme la flamme dans le bec d'une lampe. Et alors la touche fut donnée, et alors le glacis fut placé, ; et pendant un moment le peintre se tint en extase devant le travail qu'il avait travaillé.; mais une minute après, comme il contemplait encore, il trembla et il devint très-pâle, et il fut frappé d'effroi; et criant d'une voix éclatante : "En vérité, c'est la Vie elle-même!" - Et il se retourna brusquement pour regarder sa bien-aimée : - elle était morte !
|
Catégories
Tous
|



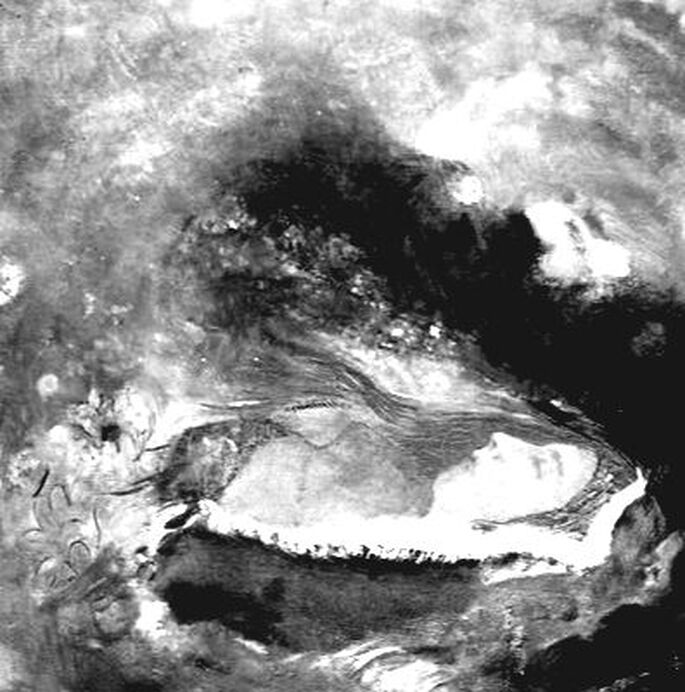
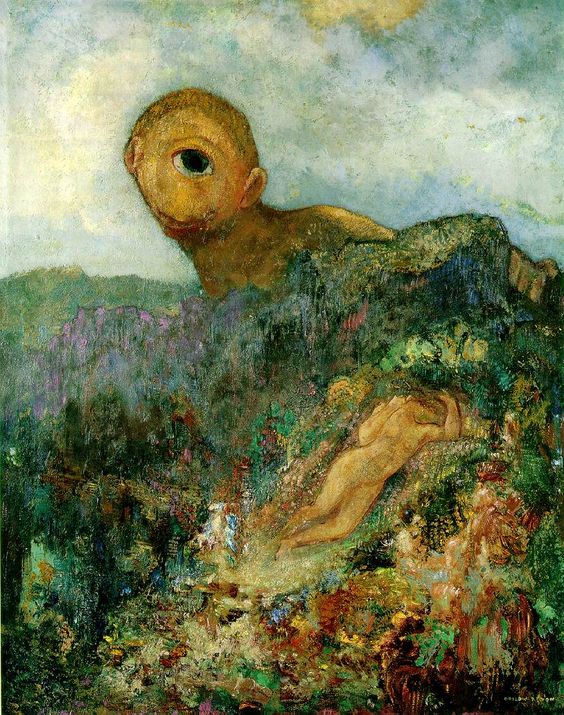





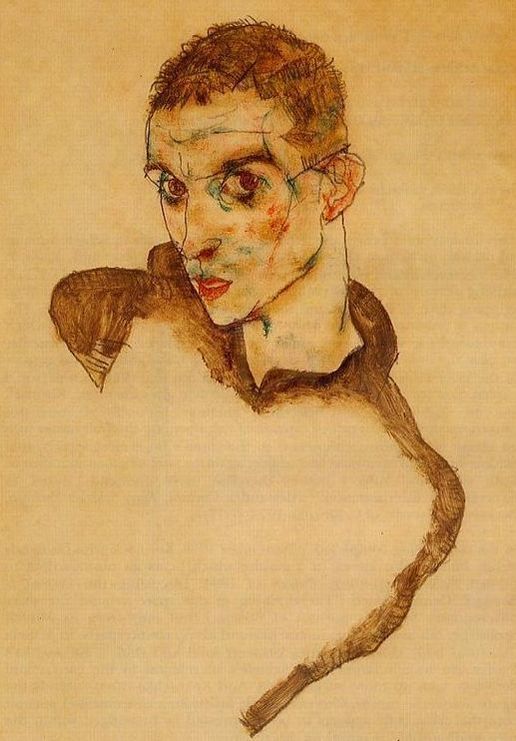


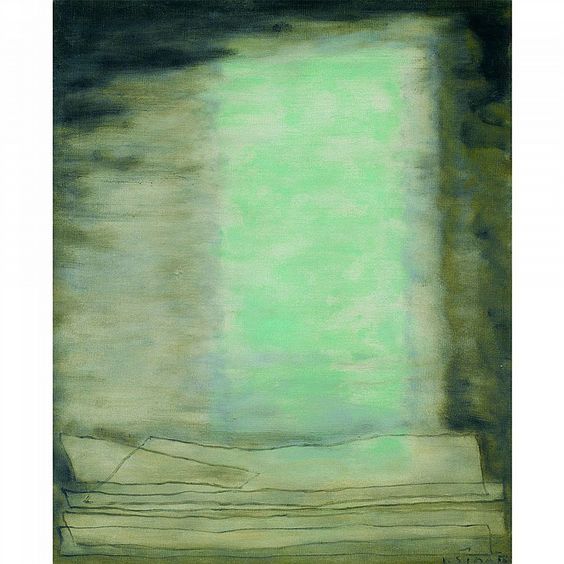






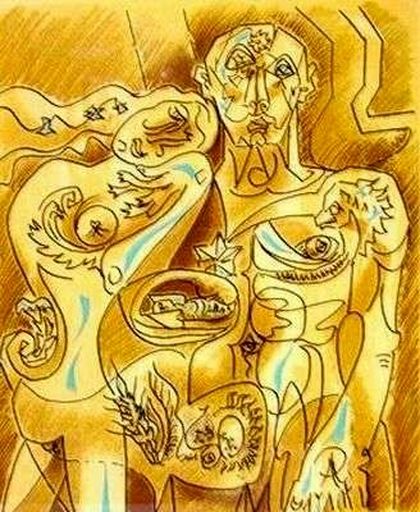




 Flux RSS
Flux RSS